>Art de vivre !
"Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser !"
William Shakespeare
"Le grand renoncement de la vieillesse qui se prépare à la mort"
Marcel Proust
In memoriam
Roland & Pierre
Dans un mouchoir de poche
Le temps de respirer
Sont partis à bas bruit
Deux chers amis proches
Errant le cœur glacé
Solitaires dans la nuit
Huit mois se sont passés
Entre les deux adieux
Je n’ai rien vu venir
De leur chemin brisé
Et maintenant plus vieux
Je pleure leur avenir
A jamais effacé
Les larmes et la pluie
Ont asséché l’envie
La joie de partager
Ni l’amer ni l’ennui
Mais l’amour de la vie
Le 29 mars 2025.
Un peu d'humour belge pour nos amis français !
La France s'apprête à former un gouvernement avec plusieurs partis et regroupements (en évitant soigneusement un). Ça tombe bien, en Belgique, on a acquis un fameux savoir-faire en matière de compromis et de coalitions "à la belge". On se permet quelques conseils.
Par Bernard Demonty, "Le Soir".
"Françaises, Français, vous savez que lorsque la situation est délicate, vous pouvez compter sur vos amis belges, comme vous dites. Et pas seulement quand il s'agit de mettre des autogoals pour vous faire plaisir. Il nous revient ce soir que vous souhaitez vous aussi entrer dans le monde enchanteur des régimes de coalitions. Pas simple, mais voici quelques règles et usages à l'attention des marieurs débutants, on a de l'expérience.
1- Restez zen. Sachez qu'au début, personne ne voudra gouverner ensemble. En campagne, vous l'avez vu, ils se sont copieusement insultés, détestés, ont prononcé des « jamais » des « c'est eux ou nous » tellement définitifs. Cela ne doit pas vous effrayer. Sachez qu'en général, ce qui est vrai le samedi avant les élections ne l'est plus le lundi d'après, c'était pour rire.
2- Commencez petit. On sait votre tendance à la grandiloquence, mais on ne devient pas belge du premier coup. Idéalement, commencez par de petites coalitions, genre deux ou trois partis. Le record du monde, que nous détenons évidemment, est fixé à sept, mais ça pose d'autres problèmes. Ah oui, à ce sujet, vous possédez un fameux atout que nous n'avons pas, vous ne devez pas avoir de Flamands dans votre gouvernement. Ça pourrait vous faciliter le travail.
3- Trouvez un château. Pour donner à votre coalition toutes ses chances, formez-la plutôt dans un château, ça fait genre. Nous vous prêtons volontiers Val Duchesse ou le Stuyvenberg, mais nous ne doutons pas que vous pourriez en trouver un plus beau près de Paris, à moins de pousser jusqu'à la Loire, il y en a de jolis.
4- Comptez les jours. Il n'y a pas de bonne coalition sans dramatisation. Quand les discussions traînent un peu trop, apprenez à compter les jours ou demandez à la presse de le faire. Vous pouvez monter au moins jusqu'à 541, ça fait un peu peur au début mais ça finit toujours par s'arranger.
5- Trouvez un arbitre. Enfin, et c'est sûrement le point le plus délicat, pour rapprocher les points de vue, nous possédons une sorte d'arbitre qu'on appelle Roi. Il peut nommer toute une série de professionnels de la médiation, informateur, préformateur, clarificateur, entremetteur, acuponcteur, assouplisseur, tout votre Larousse est à disposition pour masser les plus réfractaires. D'accord, on sait que pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer vous n'adorez plus les monarques, mais parfois ça peut aider.
6- Si rien de tout cela ne fonctionne. En dernier recours, on menace souvent, en Belgique francophone, de se rattacher à la France. Essayez dans l'autre sens, ça pourrait faire très peur ... Bonne chance !"
Le 10 juillet 2024.
Après le 7 octobre 2023, des millions de Juifs se sont réveillés avec une cible sur la tête. Même les plus éloignés de la tradition ou d'Israël ont été rattrapés par l'onde de choc. Le traumatisme des pogroms millénaires et de l'extermination des Juifs d'Europe a refait surface. Que faire ? Effacer son nom sur la boîte-aux-lettres ? Avoir peur pour les enfants ? Où aller si cela recommence ? Dans ce livre fondateur, Joann Sfar, l'auteur de la célèbre série "Le Chat du rabbin", mène l'enquête. Il discute avec ses amis, convoque son père et son grand-père, cherche des réponses dans les livres et dans l'humour. Il se rend en Israël à la rencontre des Juifs et des Arabes, avec toujours la même question, obsédante : quel avenir pour les Juifs ? Le 16 avril 2024.
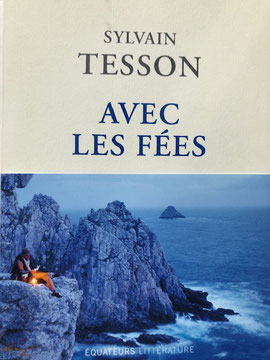
Après le ressac !
J’ai toujours passionnément aimé les livres. Ils sont nos océans, nos forêts, nos montagnes, nos plaines et nos déserts. Quand je suis en leur compagnie, je comprends mieux nos semblables. J’entrevois leurs beautés et leurs vilaines griffures, les miennes aussi.
Le voyage, que j’ai pas mal fréquenté, arpentant les continents entre ciel et terre, n’est que leur reflet, jamais aussi inspirants que mes compagnons de lecture. Déplacement ou escapade, je me suis plus d’une fois retrouvé avec le sentiment de l’exotisme, cette chose plaisante et presque vide que l’on vend dans les brochures.
Avec mes proches et le plein d’amour qu’ils me permettent de recevoir et de donner, les livres sont un essentiel. Mais une expérience récente a levé en moi une interrogation.
J’ai pris l’habitude d’offrir des livres. Je venais de lire le texte de Sylvain Tesson, « Avec les fées », sorte de recueil poétique d’émotions et de sentiments devant la beauté des côtes celtiques, de Galice, Bretagne, Cornouailles, pays de Galles, île de Man, Ecosse et Irlande. Tesson conte ses paysages intimes face à la nature vibrante comme personne. Lisez ou relisez « La panthère des neiges ». Il séduit par sa sensibilité et son intelligence, il déplaît aussi, par sa culture « si classique », que d’aucuns trouvent « réactionnaire ». La nostalgie n’est-elle pas réactionnaire ? Si, bien sûr. Une soirée « années ‘70 », constitue un acte réactionnaire. Personnellement, cela ne me pose aucun problème.
Au-delà des préjugés et stéréotypes, j’ai souhaité faire bénéficier à quelques amis et amies le dernier Tesson. C’est un paradoxe, c’est vrai, que d’apprécier la force d’évocation de la faune et la flore, du granit et de la mer, sans les voir et ressentir directement, au travers les mots d’un auteur. Rassurez-vous, la nature prend toute sa place dans ma vie. La déchiffrer dans des récits magnifiques, n’est-ce pas une autre façon de l’aimer ?
Aussi, j’ai acheté cinq exemplaires du livre. Tous m’ont semblé contents du cadeau. Genre de savoir-vivre appréciable mais quelquefois de façade. L’ont-ils lu ? Tous, sauf une personne, qui a poliment mais fermement refusé le présent.
C’était la première fois que quelqu’un faisait un acte, selon moi, aussi chargé symboliquement. A la simple vue du titre, il m’affirma que cela ne lui disait rien et qu’il préférait me remettre l’ouvrage. Je n’ai pas eu de mot. Fâché, certainement pas. Plutôt estomaqué, comme après avoir reçu un coup. Je ne comprenais pas.
Je n’en veux évidemment pas à cet ami, qui le restera. Je trouve dommage qu’un avis, quel qu’il soit, soit rendu avant, et non après, la rencontre ou la découverte. Son temps était-il à ce point compté qu’il jugea que deux ou trois heures consacrées aux fées fantasmagoriques de Tesson étaient un moment perdu ? Peut-être ai-je accordé à ce qui n’était qu’une anecdote trop d’importance ? Dans le monde de l’urgence qui est le nôtre, mon ami avait sans doute ses raisons.
Tout cela est possible. Mais je reste persuadé que les livres sont une translation et une transmission de ce que nous sommes; grains de sable dans le champ profond de l’univers, mais trace précieuse, certes fugace, que nous laissons de notre passage après le ressac. Le 13 avril 2024.
Dans les bleus de Chagall j'y ai vu ton visage
Et tes yeux dans le bal endormi de mon âge
Un baiser envolé dans le ciel en fièvre
Un passé réveillé au miel de tes lèvres
Au bal des opinions !
"Certains prennent des chemins en trompe-l'oeil et croiser le leur expose à la ruine. Tant ils ont pris l’habitude de séduire, de s’envelopper de clinquant, de ne consacrer leur talent qu’à se faire remarquer, qu’ils abusent le regard d’autrui. Ils n’ont de souci que pour leur réputation, et veulent qu’au bal des opinions on les admire. Dans cette valse incoercible qui toujours accélère, la tête leur tourne, ils perdent pied dans le réel. Drogués d’argent, ou d’honneurs, ou de sexe, ils ne sentent plus de limites. Comme, à lui seul, chacun de ces champs de l’éphémère requiert une immense expertise et consume toute l’énergie, ils choisissent l’un d’eux sur lequel ils jettent leur dévolu selon leur appétence. Chacun n’est plus qu’un outil à la disposition de leur fringale de reconnaissance. Installés dans cette puissance factice, certains arrivent même à faire croire qu’ils exercent une influence sur le cours des choses. N’ayant pour seul atout que leurs turpitudes, ils savent les enrober dans un beau drap d’or pour les faire passer pour du talent. La pauvre gloire des paillettes et du fard masque trompeusement qu’ils sont des êtres vides, vils et veules. Mirliflore, dandy, muscadin, gandin, freluquet, godelureau, cupide, avare, rapace, mercenaire, amateur avide de breloques, de guipures ou de fanfreluches, de regards de personnages haut placés dans l’intimité desquels ils se sont introduits. Pour travestir les banalités les plus désarmantes de leurs propos, ils forcent l’assurance de leur ton. A défaut d’avoir le goût du vrai, de la précision, de l’opinion argumentée, ils ont le sens de la musique des mots dont la mélodie suffit à faire oublier leurs continuels mensonges. Ils savent en varier le rythme, rapide, saccadé, lent, majestueux, tragique. La petite culture qu’ils ont, ils la font dépasser de la poche de leur veste pour attirer le regard du crédule et porter beau. Des clowns en guerre contre tous pour capter l’attention, et qui n’hésitent pas à tirer dans le dos. Tant qu’on n’en a pas rencontré, on ne sait pas cela possible, c’est là leur force." Qui a tué Spinoza ? Jean-François Bensahel, Grasset, 2023.

"Un homme qui dort, tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes."
Marcel Proust, Du côté de chez Swann.
Là où le voyage vous portera, dans la merveilleuse campagne toscane, dans le bleu Chagall, vers un bouquet de fleurs printanier ou les lèvres de l’être aimé, tel le Baiser de Rodin, de mon souffle de vie, ami(e)s de longue date ou de passage, je vous souhaite une belle, douce et longue existence !

L'art n'a pas pour mission de plaire, même si il peut plaire. Il montre, suggère, évoque, provoque, déforme, émeut. Il peut nous aider aussi à changer notre rapport au regard. Il n'est pas, tout simplement, s'il se soumet aux pensées conformes ou si il s'inscrit dans une lignée académique de reproduction. Sa valeur réelle ne se fixe pas chez les marchands. Seuls l'émotion, la modernité et le recul du temps lui donnent une valeur dans la marche de l'humanité. La culture, sa transmission comme sa pratique, est une manière d'être au monde qui libère. Elle nourrit celles et ceux qui l'embrassent et l'aiment. Ses ennemis sont toujours du côté du totalitarisme. Le communisme, le fascisme, l'islamisme et le nationalisme lui ont déclaré la guerre pour menace vitale sur leur barbarie.
Nous sommes les héritiers des trois monothéismes, de la pensée plurielle antique, illustrée par Raphaël, et des Lumières !
Un "processus de décivilisation" serait en cours !
La déclaration disruptive !
Les mots d'Emmanuel Macron ont une nouvelle fois fait mouche. Mercredi, le président de la République a comparé, en conseil des ministres, les violences, "quelle que soit la cause", à un "processus de décivilisation", selon un participant à la réunion. Cette expression a été conceptualisée par le sociologue allemand Norbert Elias dans les années 1930. Mais c'est aussi le titre d'un livre de Renaud Camus, théoricien du "grand remplacement", publié en 2011.
L'écume des jours !
Marine Le Pen s'est félicitée qu'Emmanuel Macron vienne "une fois de plus donner raison" à son parti. "Je parle d'ensauvagement depuis des années et je me fais accuser de tous les maux pour avoir fait cela. La décivilisation, c'est la barbarie", a-t-elle affirmé. La présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale regrette que le Chef de l'État "se réveille au moment où la situation est déjà très obérée, elle qui ne trouve rien à redire à la barbarie de son ami Poutine ...
À droite, Bruno Retailleau "partage l'inquiétude du président de la République": Quand il y a des phénomènes d'ensauvagement, quand l'école ne parvient plus à transmettre les savoirs, quand il y a une entreprise de déconstruction culturelle, nous assistons à un processus de décivilisation", a tweeté le président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat, réfutant qu'il s'agisse d'une terminologie d'extrême droite. Le sénateur LR avait récemment utilisé ce terme pour qualifier les violences contre les élus après la démission du maire de Saint-Brevin, dont la maison avait été incendiée.
La gauche a quant à elle accusé Emmanuel Macron de reprendre à son compte un concept "d'extrême droite". Le premier secrétaire du Parti socialiste, l'inénarable Olivier Faure, s'est indigné "qu'au moment où il défilait en solidarité avec un maire de droite ciblé par l'extrême droite, le président reprenne à son compte le concept de "décivilisation" porté par Renaud Camus, l'auteur du "grand remplacement". "Chacun jugera, l'Histoire aussi", a-t-il tweeté.
"Le concept fumeux de décivilisation lancé par Emmanuel Macron est le titre d'un ouvrage de l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus, qui veut imposer ce mot dans le débat public depuis 2011", a lui aussi rappelé le député de La France insoumise (LFI), Alexis Corbière: "Considérer que ce serait pure coïncidence est soit une farce, soit affligeant". La députée européenne LFI, Manon Aubry a également regretté que le président fasse "sienne la décivilisation fumeuse du raciste Renaud Camus", jetant "une lumière crue sur notre pays".
Du côté des écologistes, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts (EELV), Marine Tondelier, a dénoncé une "surenchère permanente" du Chef de l'État: "C'est dangereux pour notre pays", a-t-elle déclaré au micro de BFMTV. La cheffe de file des députés EELV, Cyrielle Chatelain, a fustigé quant à elle un "nouvel exemple" de la "complaisance d'Emmanuel Macron envers l'extrême droite". La NUPES ne pouvait évidemment pas rater l'occasion de marquer le président à la culotte.
La réflexion quand même !
Il est vrai que la violence se répand en France, sans doute pas plus qu'ailleurs, mais les médias français ont l'art de l'effet de loupe, transformant souvent une information, par ricochet dans la classe politique, en un pugilat pitoyable. C'est le métier de la presse, des radios et des télés, c'est aussi une caisse de résonance déformée et manipulée dans les réseaux sociaux. Personne ne peut nier que nos sociétés post-modernes sont confrontées à une montée inquiétante d'une désacralisation de la vie et, de manière corollaire, à une banalisation de la mort par agression.
Bien sûr, l'histoire est jalonnée d'épisodes tragiques qui n'ont pas manqué de ramener l'humanité à une fosse aux prédateurs. Mais le passage de la barbarie spontanée puis institutionnalisée par les régimes despotiques - monarchiques comme républicains - on a pu l'espérer, avait été suivi par une émancipation des droits de la personne, un arsenal juridique protecteur et un humanisme consacré par les révolutions libérales comme par certains courants des pensée philosophique et religieuse.
Tout cela est vrai. La pensée occidentale s'est nourrie aux sources juives, grecques, romaines, chrétiennes, musulmanes et des Lumières - citons notamment Saint Augustin, Avicenne, Rachi, Averroès, Maïmonide, Erasme, Montaigne, Descartes, Pascal, Locke, Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Hume, Rousseau, Diderot, Kant, Nietzsche ... - Sans remonter au Décalogue, source originelle d'une certaine éthique universelle, ce fut une avancée morale majeure, d'abord essentiellement livresque, dans les relations entre les personnes (l'Autre est un moi-même) et entre ces dernières et les pouvoirs du prince et du goupillon. Ils n'eurent de cesse de soumettre la sphère privée, très longtemps ignorée, le plus souvent par la peur et la force, à leurs intérêts bien compris sur la terre comme au ciel.
Mais l'avènement du XXème siècle a changé le paradigme. Alors que de considérables progrès techniques, technologiques, médicaux et sociaux se faisaient jour, améliorant les conditions de vie d'une très large majorité des populations, dans le même temps, des atteintes - c'est un euphémisme - sans précédent à la condition humaine sont venues marquer au fer rouge les peuples du Vieux Continent. Après le djihad, les croisades, le colonialisme et l'esclavage, les chevaliers de l'apocalypse étaient de retour. Deux guerres mondiales, deux idéologies mortifères sonnaient à la porte.
Le totalitarisme s'est chargé d'unir stalinisme et hitlérisme pour ensanglanter un siècle, qui aurait dû tenir ses promesses. Leur marque de fabrique: l'élimination de toute forme de résistance et d'opposition. Singularité du nazisme, l'application méthodique du processus d'éradication du peuple juif de la surface de la terre. Il y avait déjà eu deux précédents: les génocides des Héréros et des Namas, en 1904, en Namibie, par l'Empire allemand, et des Arméniens, en 1915 et 1916, par l'Empire ottoman et les Jeunes-Turcs. Les Juifs, entre 1933 et 1945 ont suivi, les Tutsi, en 1994, ensuite, voués aussi à une totale disparition; massacre organisé par les autorités et les populations hutus rwandaises.
Emmanuel Macron n'a pas dit que la France et l'Europe étaient en état de "décivilisation". Il a parlé d'un "processus", à savoir qu'il s'agit d'un horizon si nous n'y prenons garde. Le concept de "civilisation" véhicule, selon les traditions, plusieurs définitions. Dans le monde latin, héritage greco-romain, il y a LA civilisation et puis les barbares autour; entendu qu'Athènes et Rome et leurs héritiers appartiennent bien évidemment à la première. Dans le monde anglo-saxon, legs né d'un pragmatisme de la diversité ethnique davantage acceptée que dans l'univers latin, il n'y a pas UNE civilisation, mais des civilisations. Il y a là plus qu'une nuance d'approche, en fait, un gap culturel jamais comblé.
Le président français parle d'où il est, à savoir d'une nation et d'un Etat central fort, qui n'a cessé de combattre, au nom de son universalisme, toute partition territoriale et fragmentation culturelle. De Louis XIV à Emmanuel Macron, en passant par Napoléon et de Gaulle, la même obsession de la perte de contrôle. Au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, l'idée selon laquelle la nation est d'abord l'émanation de l'addition de communautés, c'est leur universalisme, qui, in fine, forme le peuple, et non la création ex nihilo de l'Etat, vis-à-vis duquel les élites comme les individus - le mot citoyen est tardif chez les Anglo-saxons - ont toujours eu, chevillés au corps, prévention, méfiance, voire rejet.
Nous pensons ici que le Chef de l'Etat français a eu raison, face à l'explosion des violences sociales et au non respect de toute forme d'autorité (des parents, des élus, des enseignants, des soignants, des pompiers, des policiers et des patrons), d'invoquer un risque de dégradation des moeurs, de la qualité de vie et du débat démocratique, pour tout dire, d'un consensus d'une certaine morale collective absolument nécessaire au maintien d'un vivre-ensemble qui fasse sens.
En revanche, comme il n'a pas précisé dans son propos s'il mettait ou non un s à "civilisation" et qu'il n'a pas expliqué les contextes culturels possibles qui éclairent différemment son acception, le recours au concept de "décivilisation" nous paraît surdimensionné par rapport aux réalités. D'autant que son emploi, on l'a vu, demeure connoté négativement dans le registre politique. Peu ont relevé que le premier à proposer le terme est le sociologue allemand Norbert Elias, qui, dans les années de la montée fasciste et nazie, alerte les opinions publiques des menaces qui planaient sur l'humanité.
L'indépassable à revivre ?
L'entreprise de "décivilisation" a bien existé, avant "l'ensauvagement" dénoncé à juste titre par les contempteurs d'une époque, la nôtre, déboussolée. Au-delà des tragédies qui ont jalonné l'histoire des civilisations, ce fut l'abîme absolu de l'organisation systématique, quand ce n'était pas industrielle, de l'élimination de peuples de la surface du globe et de la mémoire collective. Ce fut ces génocides innommables qui ont réduit notre humanité à l'état de cendre (*). Le crédit que nous accordons au propos alarmant d'Emmanuel Macron est celui d'une trajectoire incontrôlée qui nous amènerait à revivre cet indépassable. Et cela, vous en conviendrez, nul civilisé ne souhaite y sombrer à nouveau.
(*) Le XIXème siècle nous a laissé un lourd héritage aussi; les métropoles européennes en leurs "oeuvres" de colonisation ...
Le 26 mai 2023.
Vivre selon et sous le monde russe !
"Surnommé 'le mage du Kremlin' (*), Vladislav Sourkov est sans doute la figure contemporaine la plus aboutie du nihilisme. Obsédé par Hamlet, prince d’un monde déboussolé et d’un univers de faux-semblants, cherchant à brouiller les cartes en permanence."
"Après avoir fait rasé Groznÿ, chargé par Poutine de démembrer l’Ukraine, Sourkov, dans une nouvelle intitulée 'Sans ciel', publiée le 12 mars 2014, à la veille de l’annexion de la Crimée, livre la clé de compréhension de la guerre hybride lancée par le Kremlin contre nos démocraties. C’est l’histoire de villageois sur la tête desquels le ciel est littéralement tombé lors de la dernière guerre mondiale – métaphore limpide des Russes à la chute de l’URSS. Privés d’étoiles, ayant 'perdu le sens de la hauteur', ils sont obsédés par ville voisine dont l’opulence et le calme font injure à leur misère et à leurs tourments. Pour détruire cette cité prétentieuse (l’Europe), les villageois créent une organisation secrète : 'La Société'. La nouvelle se termine à la veille de l’attaque finale par ces mots : 'Nous allons venir demain. Nous allons conquérir ou périr. Il n’y a pas de troisième voie'.
Les 'incendies' déclenchés et les légendes colportées, les actes de terreur et les campagnes de manipulation de l’information, les violences et les outrances qui semblent a priori absurdes aux élites européennes servent en réalité un dessein parfaitement rationnel : l’exportation du chaos. Sourkov l’explique clairement dans un article paru dans la presse russe en novembre 2021: 'L’expansion du chaos à l’extérieur permet de remédier aux tensions intérieures'.
La volonté affichée de restaurer l’Empire déchu n'est pas simplement la quête d’une grandeur perdue. L’Empire n’est pas désiré parce qu’il apporterait la paix et la stabilité à la Russie, mais pour la raison inverse : n’ayant pas de frontières claires, ne reconnaissant que des marges mouvantes, il est en état de guerre permanent (en russe, 'Mir' signifie à la fois 'monde' et 'paix', ce qui ajoute au trouble).
'Russky Mir' ou 'monde russe' souligne que la Russie est légitime à intervenir militairement dans chaque recoin du "monde russe". Mais quelles sont les bornes géographiques de ce 'monde russe' ? Il n’a pas de limites précises ou plutôt il a les limites que lui fixe le Tsar en fonction de ses besoins du moment. Et la guerre devient une donnée constante pour les Russes et les nations qui sont décrétées appartenir à 'leur monde'."
(*) "Le mage du Kremlin", Giuliano da Empoli, éditions Gallimard.
Raphaël Glucksmann,"La grande confrontation. Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties".
Le 02 mai 2023.
Ne dirait-on pas que ces mots ont été écrits
en 2020 pour le peuple ukrainien ?
"Lorsque nous embarquons sur les fleuves homériques, résonnent des mots étranges, beaux comme des fleurs oubliées: gloire, courage, bravoure, fougue, destinée, force et honneur. Ils ne sont pas encore interdits par les agents de la novlangue managériale. Cela ne saurait tarder.
'De nos mains, non de l'indolence, viendra la lumière'. (Illiade, XV, 741).
dit Homère par la bouche d'un de ses guerriers.
A quelle place peuvent prétendre ces concepts incongrus dans une société du bien-être individuel et de la sûreté collective ? Sont-ils à jamais remisés dans le grenier des lunes ?
'Les langues antiques sont mortes', entend-on ordinairement. Ces expressions aussi ?
Pis que tous, l'un de ces mots paraît avoir été oublié au fond d'une strate archéologique: l'héroïsme. Dans les poèmes, il domine.
L'Illiade et l'Odyssée sont les chants du dépassement.
Dans cet étourdissement de batailles, ces flots de larmes et d'ambroisie, ces harangues lancées par-dessus les remparts, ces chants murmurés dans d'alcôve, ces amours où les hommes s'aiment avec la grâce des dieux et les dieux avec le ridicule des hommes, au fond de ces grottes peuplées de monstres ou sur ces plages couvertes de nymphes se dresse une figure immuable: le héros.
Sa puissance métaphysique a nourrit la culture européenne.
Elle continue à irradier notre inconscient collectif.
A chaque époque, un nouveau héros survient, chargé d'incarner les valeurs du moment.
La figure éternelle devient alors un type sociétal.
Qui est-il, cet homme armé ? Il n'a que son glaive et sa ruse pour lutter contre l'effroi du monde, la tragédie de la vie, l'incertitude des jours. Nous inspire-t-il encore, le héros de la plaine de Troie ? Nous fait-il horreur ? Est-il un étranger, un frère ? A-t-il quelque chose à nous apprendre, à nous qui avons troqué les vertus antiques contre l'aspiration au confort ?" Sylvain Tesson, Un été avec Homère, Equatteurs, avril 2020.
Peu de chances qu'Emmanuel Macron soit un grand bâtisseur !
Une certaine tradition française, de Saint-Louis, François 1er, Louis XIV, Napoléon à François Mitterrand, veut que le monarque laisse de son passage une empreinte patrimoniale digne de l'Histoire. Depuis le prince socialiste de Jarnac, peu de grands gestes architecturaux ont été posé par ses successeurs. Les crises ont de ces exigences qu'ignore la grandeur de la France. Emmanuel Macron, suzerain de la verticale, n'échappera pas à cet aplatissement. En ce domaine, il aura aussi joué les seconds rôles. Ils sont nombreux, parmi les thuriféraires des belles pierres, des charpentes et des ardoises, à être déçus que ses actions culturelles, bien réelles, "ne fassent pas une politique". La fin (provisoire) des travaux de restauration de Notre-Dame, prévue, en principe, pour courant 2024, permettra peut-être au président, qui fut l'opportun auteur de l'annonce, en avril 2019, de sa reconstruction, de sortir avec les honneurs de la liste honteuse des chefs d'Etat non-bâtisseurs. Lui qui fréquente plus souvent les chaires que les confessionnaux, lui qui aspire à rejoindre un jour les gloires passées, il pourra toujours prier La Vierge Marie pour qu'il en soit ainsi. Le 10 janvier 2023.


"Je peins la neige !"
Ainsi Pierre Soulages est entré dans son dernier noir, celui d'une nuit éternelle. Pourquoi nous a-t-il tant fasciné en recherchant dans ses noirs le reflet de nos vies ? La convention a voulu que cette couleur, qui en est une, soit dédiée à la mort, au deuil, aux ténèbres. Mais rien de plus variant dans les civilisations; la nôtre, voyant dans les maux de la fin l'avant-garde de l'obscurité. Vraiment ?Ailleurs, n'est-ce pas le blanc et la fête pour célébrer le départ ? Emancipés de nos arbitraires, il y a de la joie dans un noir Soulages; la lumière déclinée en déploiement d'éclats, traits et raies, qui ne parlent qu'à d'intérieures pensées bienfaisantes. Comme si la jouissance de parcourir le théâtre clair-obscur de ce chercheur d'ombre finissait par combler en nous les trous noirs de nos ignorances infinies. Quelqu'un a dit que l'oeuvre de Pierres Soulages était une conversation avec les siècles. Assurément, avec le temps, avec son époque, avec nos fragments d'existence. "Je peins la neige", dit-il, peu importe l'apparence; c'est l'éphémère dans le champ profond et invisible de notre passage.
Photo écran télé ©LCDV, pas un tableau Soulages: 24 décembre 1919 / 26 octobre 2022. Le 03 novembre 2022.
Le cinéaste est mort à l'âge de 91 ans par suicide assisté. Gérard Darmon vient de rappeler sa haine du peuple juif.
Mort de Jean-Luc Godard :
"Je ne peux pas admirer quelqu’un qui hait à ce point les Juifs" !
Gérard Darmon vient de rappeler, pour les amnésiques ou les non-informés, quitte à être "à contre-courant", sur l'antenne de France 5, à C à vous, l'antisémitisme idéologique de Jean-Luc Godard. Le cinéaste suisse de la "Nouvelle Vague", des années '60 à 2006, a continué à affirmer que les Juifs s'étaient laissés massacrer par les nazis pour permettre, trois ans plus tard, la création d'Israël ... Comment vomir sa haine des Juifs et de l'Etat hébreu derrière le masque du "grand homme" ?
Voici précisément les propos tenus par le réalisateur du "Mépris":
"Les attentats-suicides des Palestiniens pour parvenir à faire exister un État palestinien ressemblent en fin de compte à ce que firent les Juifs en se laissant conduire comme des moutons et exterminer dans les chambres à gaz, se sacrifiant ainsi pour parvenir à faire exister l’État d’Israël", témoignage du documentariste Alain Fleischer, dans "Morceaux de conversations avec Jean-Luc Godard", 2007.
Il y a aujourd'hui une propension esthétique, on le voit avec l'exaltation pour Louis-Ferdinand Céline et ses romans, qui vise à escamoter la dimension éthique du rapport entre une oeuvre, l'auteur et la réception sociétale de ce rapport, qui n'est pas innocente. Si les gestes et les actes peuvent tuer, les mots sont loin d'être vierges dans l'art de neutraliser, voire d'annihiler, par effet collatéral, un ennemi.
Le 15 septembre 2022.

"Au pays du rêve, nul n'est interdit de séjour"
Julos Beaucarne
En notes et mots, la laideur devenait belle, la tristesse joyeuse !
Le 2 février 1975, le jour de la Chandeleur, un homme, recueilli fraternellement par Julos et son épouse, que l’on a dit déséquilibré, porta plusieurs coups de couteau dans le corps de Loulou, celle qui accompagnait et aimait tendrement le troubadour wallon. Ce 18 septembre 2021, notre poète à la douce présence s’en est allé à son tour rejoindre quelque part son amour. Il nous lègue 500 chansons et 18 livres, des souvenirs plein le coeur. Il sut nous porter à hauteur de sagesse, nous contant l'essentiel de ce que nous sommes et devenons, de l'aube au crépuscule, des peines sous-marines aux joies qui élèvent. Le jour même de la disparition de sa compagne, écrasé par le chagrin, Julos se mit à son écritoire et, de sa belle plume de coq wallon, coucha sur le papier une prière. Depuis, il ne cessa de nous enchanter par ses notes et ses mots; les choses, les êtres et leurs liens dits avec tendresse aux allures de caresse. Blotti dans nos paysages d'aventure, il n'est parti que de corps, imprimant l'urgence d'aimer sur toutes nos aventures humaines. Avec lui, la laideur devenait belle et la tristesse joyeuse. Je n'ai rien oublié de sa supplique:
" Amis bien-aimés,
Ma Loulou est partie vers le pays de l’envers du décor - un homme lui a donné neuf coups de poignard dans sa peau douce - c’est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d’aplomb et d’équerre par l’amour, l’amitié et la persuasion. C’est l’histoire de mon petit amour à moi arrêté sur le seuil de ses 32 ans. Ne perdons pas courage, ni vous, ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus et mes deux chéris qui lui ressemblent. Sans vouloir vous commander, je vous demande d’aimer beaucoup plus que jamais ceux qui vous sont proches. Ce monde est une triste boutique. Les coeurs purs doivent se mettre ensemble pour l’embellir. Il faut reboiser l’âme humaine. Je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. A travers mes dires vous retrouverez ma bien-aimée. Il n’est de vrai que l’amitié et l’amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, son sac de charbon pour aller au paradis. Ah ! j’aimerais bien qu’il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres mes amis de l’ici-bas, face à ce qui m’arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu’un histrion, qu’un batteur de planches, qu’un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd’hui: je pense de toutes mes forces qu’il faut s’aimer à tort et à travers."
Avec la Wallonie, Julos aimait profondément la Provence, les Alpilles, le Luberon particulièrement, qui l'habitaient autant qu'il y goûtait pleinement la vie. Il nous en laisse une jolie déclaration:
" Je hume à perdre haleine l’air / Que je sens venir de Provence / Car de là-bas un rien m’enchante
Et tout le bien qu’on m’en rapporte / Je l’écoute avec un sourire / Et pour un mot j’en voudrais cent
Tant m’est beau tout ce qu’on peut dire / Je ne sais de plus doux séjour / Que depuis Rhône jusqu’à Vence / Entre la mer et la Durance / Qu’il y ait quelque chose de plus doux que Provence / Et qu’amour ne soit rien aux frères du Midi / Laissez-le dire à d’autres / Je hume à perdre haleine l’air / Que je sens venir de Provence / Car de là-bas un rien m’enchante."
Différentes circonstances de la vie m’ont permis de le rencontrer. Une première fois, à quelques pas de mon quartier d'enfance, que j'avais quitté pour d'autres horizons. J’étais alors un jeune homme en quête de souffle. Sous chapiteau, Julos était venu chanter et partager sa façon légère et grave d’être au monde, repeignant ses noirs et gris en vert et rose. Après nous avoir rempli les yeux d’étoiles et les oreilles de chants d'oiseaux, j’ai eu la chance d’échanger avec lui sur l’influence de la poésie sur le monde réel. Humble, il m’avait répondu ne rien attendre, surtout des grands hommes, trop fatigués pour entendre "ma petite musique", rien non plus de leurs décisions gravées dans le marbre de l’histoire. En revanche, ils espérait des sans-grades, de leur capacité à épouser la vie. C’était là, je crois, une façon de réaffirmer la primauté des imaginaires sur la relativité des pouvoirs.
Vingt années plus tard, je résidais dans le Brabant wallon et la proximité de Tourinnes-la-Grosse, où Julos vivait une partie de l’année, l’autre dans sa chère Provence, m'incita à aller le retrouver sans rendez-vous, prenant le hasard à témoin. Il était là, à fabriquer avec des bobines de bois une sculpture monumentale dédiée à ses songes autant qu'à l’éphémère. Sans me connaître, sans se rappeler notre courte discussion deux décennies plus tôt, il m’accueillit tel un frère qu’il était, toujours posé comme un ange sur notre épaule dans un for intérieur pudique. Et pourtant, totalement ouvert à la rencontre. Je lui lu un de mes poèmes sur la perte de l'être aimé. Il m’écouta sans mot dire, sans maudire, deux larmes coulèrent au sillon de son regard lumineux. Il m'offrit une tasse de thé agrémenté d’herbes secrètes. Je partis avec son âme herbacée accrochée à la mienne.
J’ai longtemps travaillé aux côtés « de grands hommes et d’une grande femme », ministres absorbés par leurs affaires intérieures et les dossiers publics, l’oeil inquiet et rivé sur leur clientèle, leurs mandats et les élections. C’est ainsi qu’un jour de 1999, soit quatre ans après le thé vert, à la demande de la ministre, je reçus Julos Beaucarne dans mon bureau. Il était venu demander une subvention pour un événement dont j’avoue avoir oublié la teneur. Après avoir écouté l’homme arc-en-ciel - un pull chamarré aux couleurs de la diversité le quittait rarement - débattu avec lui de ce pour quoi il était venu - une présence aussi incongrue dans un lieu de pouvoir qu’un bâton de pèlerin dans une station orbitale - nous en vînmes à parler poésie et musique. Il se souvenait de ma venue impromptue chez lui et du modeste texte que je lui lus. L’émotion était intacte et, dans ce lieu grotesque pour partager des notes et des mots, je lui demandai de me lire la prière à Loulou et aux humains. J’avais apporté le texte, qui m’avait suivi dans mes déménagements. Il vibre encore à mes côtés. Julos refusa et s’excusa de ne pas pouvoir assurer. Puis, se ravisant, la main sur la poignée du bureau, revint vers moi. Il se rassit et me demanda de lui remettre le texte. Il lut lentement, comme pour réinvestir en solitaire une peine enfouie, jamais disparue. Les larmes silencieuses furent alors les miennes. Il n’y avait plus de conseiller ministériel, de chanteur de joyeuses ballades, juste deux êtres unis par la contingence, sans la nécessité, par la douleur de l’absence et la conscience aiguë d’appartenir au monde furtif des passagers de la terre. Le 20 septembre 2021.

>A la recherche des temps enfouis de mon ami Henri !
Je connais Henri Deleersnijder depuis plus de 40 ans. Nous nous sommes rencontrés fin '70, au XXème siècle, dans les salles de meetings politiques de gauche, lors de conférences sur des sujets historiques et culturels à l'Université de la Cité ardente, autour d'une bière artisanale à la Taverne Saint-Paul. Et puis, le temps a fait son oeuvre. Nous nous sommes perdus de vue. Pourtant, de loin en loin, en dépit de mes nombreux déménagements et de mes diverses activités professionnelles, en Belgique et à l'étranger, je continuai à suivre son parcours. Professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire, diplômé en Arts et Sciences de la Communication de l'Ulg, aujourd'hui ULiège, chercheur infatigable, auteur de nombreux ouvrages, Henri est un arpenteur des siècles. Sa façon de nous parler est évidente, sa science des faits historiques ne s'embarrasse jamais de l'habillage abscons d'un académisme prétentieux et recuit. Une fois lecture faite de ses écrits, ils jouent en nous les lanceurs d'alertes, indispensables à toute vigilance civique et démocratique. Ses livres sont pour moi des marqueurs d'une condition humaine en lutte permanente pour son unité et, dans le même temps, pour sa diversité, pour sa survie aussi, aux côtés de celles des espèces animales et végétales.
Je ne citerai que quelques références incontournables si l'on désire aborder les thèmes ouvragés par un auteur qui n'aime tant que questionner le cycle long pour comprendre la mesure de nos présents. Dans ce registre, il y a, entre autres, "Les prédateurs de la mémoire", "Démocraties en péril", "Le nouvel anti-sémitisme", "L'Europe, du mythe à la réalité" et, tout récemment, de manière fort à propos, "Les grandes épidémies dans l'histoire", chez Mardaga. Je reste admiratif devant sa capacité renouvelée à borner nos traces vers l'horizon qui pointe.
Henri est un ami précieux, qui m'enrichit à chacun de nos échanges de sa vaste connaissance de l'histoire, de ses anecdotes savoureuses et d'un humour attachant et révélateur. Car, derrière la faconde du conteur d'histoires, il y a une intelligence mobile au service d'un humanisme jamais démenti. Hier matin, nous avons marché ensemble plusieurs heures et puis déjeuné avec mon épouse. Je lui ai fait découvrir les chemins et les espaces de mon enfance, sur les vallons du Ry-Ponet, du Bois du Baron et de Sainte-Anne; 400 hectares de campagne, vallées et collines, préservés jusqu'à ce jour de l'appétit vorace des promoteurs et financiers. Ce fut un moment d'intense complicité et d'une amitié nourrie, je crois, aux trois passions qui nous animent: comprendre, partager et donc voyager. J'attends maintenant son invitation pour arpenter à mon tour ses propres lieux de mémoire, là-bas, sur les crêtes indistinctes à mes yeux de Flémalle-Haute, terroir des escapades en culottes courtes et premiers pantalons du petit et jeune adolescent Henri Deleersnijder.
Son papa fut ouvrier sidérurgiste dans les aciéries Cockerill de la vallée de la Meuse. Le mien fut employé métallurgiste au château de Seraing, dans la même entreprise, alors mère nourricière de dizaines de milliers de familles du bassin liégeois et, au-delà, jusqu'aux terres sablonneuses du Limbourg flamand. Jadis, ces dernières pour partie, appartenaient à la Principauté éponyme de l'actuelle Province de Liège, Etat ecclésiastique, fier et indépendant au sein du Saint-Empire Germanique et fidèle à la France. Ce qui lui valut une mise à sac et la dévastation par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, à l'automne 1468, alors ennemi juré du roi de France, LouisXI. Ce patrimoine familial et régional commun n'est pas à mes yeux qu'anecdotique. Il signe entre nous, me semble-t-il, une fraternité autant spirituelle que mémorielle, qui trouve son prolongement dans des attaches philosophiques qui ne doivent rien au hasard.
Bref, j'aime ce Liégeois aux origines limbourgeoises, fils de Principauté de Liège et de France, avocat des fragilisés par l'histoire, fidèle notamment à la mémoire juive, sensible à son destin singulier. A l'heure de l'inattendue et fulgurante crise sanitaire, qui ravage le monde, les corps, les coeurs et les esprits, qui isole plus que jamais les solitudes, qui frappe de nombreux secteurs commerciaux et économiques, les finances des familles comme celles des Etats, je ne saurais trop vous conseiller de lire le dernier ouvrage de mon ami.
"(...) Fameux coup de semonce pour notre humanité ! Et pour un monde développé qui se croyait à jamais à l'abri de crises sanitaires d'une ampleur aussi stupéfiante. C'est peu dire qu'il a senti passer le souffle de l'apocalypse. (...) C'est à tenter de décrypter, à ce jour, plusieurs effets durables de la pandémie de Covid-19 que le présent essai s'emploie. Il entend surtout faire un retour sur d'autres grandes épidémies qui ont marqué l'histoire des peuples, jusqu'à infléchir leur destinée: de la "peste" d'Athènes au Vème siècle avant notre ère jusqu'à la grippe dite "espagnole" de 1918-1919, en passant par la Peste noire du milieu du XIVème siècle - meurtrière entre toutes - et les explosions de choléra en Europe, au cours du XIXème siècle".
Les parallèles que l'auteur établit entre ces passés et notre présent sont saisissants; ils nous invitent à prendre la distance nécessaire pour tenter de comprendre le sens et la portée des événements sur l'existence des humains.
Le 15 avril 2021.
Louis Comfort Tiffany n'a pas créé que des lampes. Ses vitraux sont un enchantement.
Le New-Yorkais porte ici son art de la polychromie et de la transparence à son apogée.
Illustration du printemps: Magnolias et Iris


Bémol !
Le monde d'aujourd'hui est comme une prison
N'est-il pas interdit d'y jouir de la vie
De rêver sans raison et d'aimer sans façon
Le monde d'aujourd'hui ne nous dit pas son nom
Asphyxie l'horizon à l'ombre de nos nuits
Ne s'est-il pas construit sur le pouvoir du non
Personne n'est coupable du fruit de nos impasses
Mais tous sommes en devoir d'entendre le tocsin
Vous et moi comptables de porter la menace
En ferons-nous le feu de nos prochaines années
Célébrant l'incendie de nos bonheurs anciens
En ferons-nous l'enjeu de nos humanités
La fête reviendra-t-elle nous prendre le chagrin
L'amour et l'étincelle nous rendre un lendemain
Le 28 février 2021.
>La vie est belle si nous acceptons la joie de la vivre !
Frank Capra a permis à James Stewart et Donna Reed d'offrir aux spectateurs la joie d'être uniques et vivants !
Ce soir, sur ARTE, ne manquez surtout pas "La vie est belle" de Frank Capra, 1946, It's a wonderful life, en anglais. Une vision romanesque, certes, mais aussi réaliste des Etats-Unis de l'avant, pendant et après Seconde Guerre mondiale. Une histoire d'amour, entre romantisme et quotidienneté, sur fond de peinture sociale sans fard.
Le thème est universel: la vie, son oeuvre, vaut-elle la peine (la joie) d'être vécue ? Capra répond par l'affirmative - c'est son ADN - sans occulter la difficulté de vivre dans un monde où le pouvoir de l'argent, le cynisme et la détresse humaine nous entourent.
Capra nous dit que nos rêves inaccessibles ne sont pas vains, car ils nous donnent l'énergie d'agir, mais que ce que nous avons de réel entre les mains, que nous ne voyons pas toujours ou plus, à force de tracas, de tourments et de fracas, entre rêve et réalité, est bien plus important que toute la dureté sociale.
Notre bouée de sauvetage n'est autre que nous-même. Par nos paroles, gestes et actes, nous transformons le monde sans nous en rendre compte, nous offrons à nos proches - connaissances, amis, famille et amours - la chance de vivre la plus belle part de l'humanité, dès lors que nous avons choisi le camp de la solidarité et de la générosité.
C'est un film sur la joie, qui n'est autre que la seule réponse possible à la vie, telle qu'elle est, que nous avons le privilège, malgré tout, de traverser. Le 29 décembre 2020.
>L'art de vivre au long cours !

Il y a quelques semaines, j’ai eu le bonheur de retrouver un vieil ami, le chêne que j’ai planté il y a 60 ans dans le jardin de mes parents. Je l’avais prélevé dans le bois de mon grand-père maternel à Hasselt, j’avais 4 ans. Il est toujours là, présent à lui-même et au monde, fait pour me survivre et résister aux défis du temps. Je l’ai remercié de m’avoir donné de la force pendant 50 ans; j’allais le voir et l’embrasser à chaque passage chez ma maman, décédée en 2011. Je lui ai souhaité belle route dans sa vie au long cours. Le 13 décembre 2020.
>Une histoire de dingue !
Vendredi, il m’est arrivé un truc de dingue. Je vais à l’épicerie là où j’ai l'habitude de faire des courses en semaine, avec la prudence dictée par notre nouvelle drôle de vie.
Masque, entrée sécuritaire, gel et tout et tout.
Une fois mon panier rempli, je dépose mes achats sur le tapis de caisse et, alors que j'attends mon tour, le billet de 50 euros avec lequel j'allais payer tombe par terre.
Le type devant moi, un gros baraqué qui était en train de finir de payer ses achats, se penche lentement et récupère mon billet. Je me dis que les mecs sympas et attentifs ça ne court pas les rues. Je tends la main avec un grand sourire, attendant qu'il me rende mon argent, en essayant de rester à l'écart, tout en me préparant à le remercier pour le geste.
Mais tout à coup, il me sort ce truc qui m'a laissé sans voix - « Ce qu'il y a sur le sol appartient à celui qui le trouve ! » - et juste comme ça, il part... sans se presser, comme s'il n'avait rien fait de mal.
J’ai regardé la dame derrière moi et les gens autour qui avaient assisté à la scène, ils m'ont tous rendu un regard atterré et incrédule, murmurant des choses entre eux.
J’aurais pu appeler la sécurité, mais cela m’a semblé tellement dingue que j’ai voulu régler ça moi-même... J'ai laissé mes achats par terre et je l’ai suivi sur le parking, pour récupérer mes 50 euros Je me suis rendu compte que deux clients qui étaient près de moi m'accompagnaient, pas mal costauds eux aussi... ça m’a rassuré, l’autre abruti était vraiment une baraque.
Je me suis planté sous son nez, lui demandant mon argent, mais il m'a regardé avec mépris et a agi comme si j'étais invisible.
Il a lentement mis ses deux gros cabas par terre pour sortir la clé de sa poche et ouvrir le coffre, et tout d'un coup je me suis dit: « C'est maintenant ou jamais ! »
J'ai pris les deux sacs et je lui ai dit - « Ce qu'il y a sur le sol appartient à ceux qui le trouvent ! » - et je me suis mis à courir comme un dingue vers ma voiture, entre frayeur et rire, assez content de moi en fait.
Les spectateurs ont commencé à applaudir et former un cordon de sécurité pour empêcher mon gros malin de me poursuivre.
Il n’a même pas essayé en fait. Trop humilié, j’imagine. Il a rageusement quitté le parking au volant de sa voiture, en abîmant des plots de sécurité sur son passage.
J'ai ressenti une montée d'adrénaline, de peur et de nervosité, mais ensuite j'en pleurais de rire.
Quand je suis rentré, j'ai ouvert les sacs et j'ai trouvé :
- 2 kg de grosses crevettes fraîches,
- 1.4 kg de filet de saumon frais
- des beaux morceaux de fromages à la coupe et des yaourts bio
- du pain de mie complet
- 2 paquets de tagliatelles fraîches
- 2 kg de pommes rouges bio
- 1 kg de poires williams rouges
- 2 grands pots de miel bio
- 1 bouteille de vinaigre de vin blanc Percheron
- 1 grand pot de moutarde à l'ancienne
- 2 plaquettes de beurre d'Échiré
- 1 bouteille de Sancerre 2017 et une de Brouilly
- 1 bouteille de Pineau des Charentes
Je n'avais jamais fait autant d'achats avec 50 euros !!!
Et maintenant me voilà chez moi, il est 21 h 15. Je suis en train de me taper un verre de Sancerre tout en savourant un curry de crevettes, en me demandant ...
AVEZ-VOUS LU ÇA JUSQU'ICI ?
Cela ne m'est évidemment pas arrivé. C'est juste une campagne pour promouvoir la lecture !
La lecture stimule l'esprit et l'imagination, nous fait voyager vers d'autres endroits et aide même à communiquer.
Si vous voulez copier et coller et provoquer le sourire de vos amis, s'il vous plaît allez-y, stimulez l'esprit de quelqu'un d’autre. Le 10 novembre 2020.

Seras-tu là ?
Le chemin est long, parfois trop long pour l’amour qui s’épuise, un au revoir muet en guise de fatigue. Être encore là aux côtés de l’aimé(e), à l’heure mauvaise de l’effacement de ce que nous fûmes, à la saison froide de l’éloignement sournois, lui dire notre présence dans ces instants cruels, mangeurs de beauté et de bonheurs, oui, c’est là où l’amour sans condition se niche, enfoui dans nos pudeurs honteuses quand se tarit la source de vie, juste avant le saut final, n’est-il pas lumineux de lui déclarer notre flamme immortelle ? Le 02 octobre 2020.
> Le hasard et la nécessité de retrouver Gisèle Halimi !
Hier, 28 juillet 2020, soit 93 ans et un jour après sa naissance dans le quartier populaire de La Goulette à Tunis, Gisèle Halimi, « La Kahina », la flamboyante prêtresse de la cause féministe, remisait une dernière fois sa robe d’avocate dans la mémoire collective autant que dans le grand livre de l’histoire des femmes.
C’est le mot « flamboyante » qui m’est venu à l’esprit à l’annonce de sa disparition. Depuis, son beau visage et ses mots parcourent mes souvenirs d’homme bousculé, si souvent interpellé par le juste combat de nos sœurs en humanité. L'égalité des sexes n'est guère dans la nature, elle ne peut être que dans le droit. C'est ainsi que j'ai compris le message des féministes et donc l'urgence du siècle d'accoucher de nouvelles lois garantissant aux femmes égalité, intégrité et fraternité.
S’il fallait retenir deux événements qui marquèrent les consciences et qui firent avancer les droits des femmes en France et en Europe, il nous faut évoquer deux procès retentissants auxquels Gisèle Halimi prit part en tant qu'avocate de la défense pour le premier, défenseure de la partie civile dans le second.
En novembre 1972, le procès de Bobigny fut celui de cinq femmes jugées pour avortement illégal, dont une mineure après avoir été violée. Celle-ci fut relaxée devant le tribunal pour enfants. Deux des adultes le furent aussi, une fit l’objet d’une prescription au bout de trois ans de procédure, la dernière fut condamnée à un an de prison avec sursis ainsi que le paiement d’une amende.
Quoi qu’il en soit, Gisèle Halimi a fait de ce procès un symbole, avec l’aide de Simone de Beauvoir et de nombreuses autres personnalités. Il aura un impact considérable sur la société française tout entière, dont Simone Veil se saisira, en janvier 1975, pour faire adopter par l’Assemblée nationale et le Sénat sa loi de dépénalisation de l’IVG. Grande victoire du droit sur l'obscurantisme et la réaction.
En août 1974, deux jeunes touristes belges furent violées dans les Calanques de Marseille. Le procès se tint en mai 1978, à Aix-en-Provence. Gisèle Halimi mène la charge contre un modèle de pensée patriarcale, qui considère le viol, le plus souvent à bas bruit mais pas toujours, comme le fruit de la nature humaine, des fantasmes ordinaires des hommes et des provocations des femmes …
Il serait erroné de prétendre que ce procès médiatique et l’activisme militant de l’avocate ont changé radicalement les choses. Malheureusement, la violence morale et physique faite aux femmes frappe toujours et encore dans les chaumières. Nombre de conjoints se comportent à leur égard comme des sauvages, les brutalisant en ce compris jusqu’à la mort. Les chiffres des homicides intra-familiaux sont insupportables. Ce procès a tout de même permis la reconnaissance par la justice de la gravité du viol et de son impact dévastateur sur les victimes.
Le hasard ou la nécessité m’a fait ce matin un petit tour. Vingt-quatre heures après le décès de Gisèle Halimi, me voilà à parcourir les livres de la grande bibliothèque de mon épouse. Je fais régulièrement cela dans la mienne, recherchant ici et là les traces de lectures passées chargées d’émotions, de savoirs ou d’initiations. Faire renaître à la vie un livre endormi n'est-il pas un acte de résistance ?
Au-dessus de plusieurs ouvrages d’une rangée consacrée aux romans historiques – Michelle est historienne – une languette dépassait. Voulant la retirer, je m’aperçois qu’elle était retenue à l’arrière. Saisissant le bout de papier, j’ai senti la présence d’un isolé, un livre rejeté au fond du trou.
Une petite voix intérieure me disait d’insister et de trouver l’origine du blocage. Après avoir déplacé la rangée du devant, ma main droite put accéder à l’abandonné. Et je lus sur la couverture : « Gisèle Halimi, Histoire d’une passion, Plon. » - Ah, me dis-je, Michelle ne m’a pas dit qu’elle lisait ce genre d’ouvrage. Celui-ci plutôt perdu dans une famille voisine. J’ouvris la première de couverture. Il était écrit: A toi, mon amour, qui es déjà une si chouette Mamidou. Liège, le 9 avril 2011. Rol
Cette « passion » que soulignait le titre du livre était celui de Gisèle pour sa petite-fille, M. Cette femme, devenue grand-mère, n’avait pas eu de fille, à son grand regret, et avait eu avec sa propre mère, Fritna, tout aussi juive qu’elle, une relation douloureuse, voire impossible.
Fallait-il que Michelle lise ou relise ce livre pour se plonger dans le lien unique d'une autre mamie avec sa petite-enfant ? Certainement. Car le hasard d’avoir retrouvé ce livre neuf ans après son achat et l’amour de Gisèle pour M ne nous ramènent-ils pas à une nécessité, celle de rendre les petites-filles aussi égales aux petits-garçons, aussi libres et épanouies dans leur vie de femmes que la condition humaine et l'Etat de droit le permettent ? Assurément.
« Il reste que j’ai vécu, d’une manière un peu insolite, une passion totalitaire. Et qu’elle a construit une histoire. Et que cette histoire a révélé une capacité d’aimer et de désespérer que je ne soupçonnais pas en moi. Un paroxysme un peu hors sujet(s), dont la force inattendue a transformé ma vie de sexagénaire (*). Et l’a enrichie en la doublant d’une autre vie, sans doute cachée dans la part d’ombre que chacun(e) porte en soi ». G.H.
(*) "Histoire d’une passion" est paru en 2011, mais ce passage est extrait du journal des années 2001-2004 de G.H.
Le 29 juillet 2020.
Covid-19: La leçon existentielle de Perséphone !
La mythologie grecque nous enseigne bien souvent, à nous, pauvres et merveilleux humains, l’humilité face à l’adversité. Elle nous dit aussi combien la sortie de crises ne se fait jamais sans une grande capacité d’adaptation. Vivre, c'est se résilier. C’est sans doute ce que l’humanité devra faire une fois la crise sanitaire du Coronavirus apaisée. J’écris apaisée et non terminée, car, selon les meilleurs virologues et infectiologues, une telle pandémie, si elle connaîtra des épisodes de rémission, selon les régions du monde et les époques, permettra au Covid-19 de se tapir quelque part dans les entrailles de la planète pour, sans crier gare, nous frapper à nouveau, ici ou là, selon un développement inopiné et aléatoire. C’est qu’il pourrait muter et renvoyer les vaccins, qui ne manqueront pas d’être mis en service d’ici plusieurs mois, voire un an, à leurs chères études. Bien sûr, plus il y aura de personnes contaminées, plus l’immunisation sera collective. En attendant, beaucoup de malades vont mourir d’insuffisance respiratoire. Reste la perversité de ce virus et nos incertitudes.
Venons-en à la leçon de choses. Fille de Zeus et de Déméter, Perséphone est dotée d’une rare beauté. A tel point qu’elle attise la convoitise d'Hadès, maître des Enfers. Alors que Perséphone se promène en tout insouciance dans la campagne grecque, Hadès surgit des entrailles de la Terre et s’empare d’elle par surprise. Inquiète de la disparition de sa fille, Déméter interroge Hélios, le dieu du Soleil, témoin du rapt. Il lui révèle la vérité. Horrifiée, elle refuse d’assumer ses fonctions de déesse de la Fertilité tant que Perséphone ne lui est pas rendue. Les champs ne produisent plus aucune céréale, une terrible famine se profile. Zeus doit réagir. Ainsi, il ordonne à Hadès de libérer la captive séance tenante. « Impossible, lui répond ce dernier. Perséphone s’est nourrie durant son séjour aux Enfers, et tout le monde sait que quiconque ayant goûté à la nourriture des morts ne peut retourner dans le monde des vivants … ». Zeus tranche la question par un compromis : Perséphone ne pouvant être totalement délivrée des Enfers, elle est condamnée à y rester six mois par an. Ce kidnapping aura finalement d'heureuses conséquences. Car le destin de la malheureuse symbolise désormais le cycle de la vie : tout comme elle, la nature se réfugie sous terre lorsque l’hiver arrive. Au printemps, Perséphone sort du monde souterrain et c’est toute la nature qui renait. Sans l'équilibre de la mise en sommeil et de l'éveil, la vie est impossible. Incontestablement, il y a là une leçon fondamentale à retenir.
Peut-être pourrions-nous nous inspirer de ce récit. Faisons court, et si nous renoncions à conquérir le monde, à dominer toujours plus la nature, à nous comporter comme si nous étions immortels, à faire du temps, non pas un allié, mais un ennemi redoutable ? « Qui trop embrasse mal étreint ! », dit le dicton populaire. Nos sociétés insatiables en ont trop fait et la période de confinement imposée que nous vivons aujourd’hui devrait nous aider à prendre un indispensable recul. Le Coronavirus est un ennemi implacable, comme le monde des Enfers grec. Hadès est à l'oeuvre depuis des millénaires et l'Histoire a souvent été tragique. Mais il nous donne aussi l’occasion, telle Perséphone et la nature pendant l’hiver, de nous retirer du monde pour un temps. Nul ne sait ce que l’avenir nous réserve de bon, de moins bon et de mauvais. D’autres épreuves jailliront tôt ou tard en nos routines fatiguées. A chaque fois, c'est une évidence, l’opportunité se présentera de prendre la vraie mesure de notre condition humaine face au temps, à l’espace, aux joies, aux malheurs et à la mort. Il s'agira de réévaluer à chaque fois l'impact de nos décisions et de nos indécisions, le poids de la puissance que nous avons acquise sur nos environnements, mais aussi celui de notre impuissance à les respecter. Les moines cisterciens le savent depuis saint Benoît (480 - 547), pour l’éprouver au quotidien dans leurs lieux retirés de prière et de travail: une retraite, un confinement désiré ou imposé peuvent être une chance, si nous savons en comprendre la leçon existentielle pour notre espèce. 21 mars 2020.

Mon amie, Patricia Michat, artiste céramiste, travaille la matière avec des doigts de fée. Sur ces vases est écrit le numéro matricule 78651, celui tatoué sur le bras de Simone Weil à Auschwitz durant la Shoah. Son père, André Jacob, sa mère, Yvonne Steinmetz, et son frère, Jean Jacob, y seront exterminés. Simone en réchappera avec ses soeurs, Madeleine et Denise. Elles y étaient arrivées le 15 avril 1944. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'Homme est gravé en hébreu sur ces oeuvres: "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité."

Nouvelle d'Emilie K !
Rue des boutiques abandonnées
Ma mère m’a dit : « Va chercher du travail, j’en ai plein le cul de te voir traîner comme ça ! » Ce serait donc moi le responsable de son gros cul, j’ai pensé ? Plus monstrueux chaque jour, vu qu’elle ne le bouge pas beaucoup du canapé. Elle l’y pose dès le matin, avec devant, sur la table basse, ses clopes, son cendrier dégueulasse, qu’elle ne vide jamais, qui vomit ses mégots et qui sent la mort et un pack de bières, bien sûr. Et, aussi ses pieds, gonflés et malpropres. « Va chercher du travail, bon sang ! Y en a de l’autre côté de la rue, c’est le Président qui l’a dit ». — « Quel président, que je lui ai répondu » ? — « T’es vraiment con, toi ! Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant pareil ? Le Président de la République, pardi ! ». Je devais la regarder avec des yeux ronds, parce qu’elle a pris un drôle d’air, mais c’était seulement parce qu’elle était gênée par un rot qui ne voulait pas venir. « Tu traverses la rue, et tu vas chercher du travail de l’autre côté, puisqu’il y en a. C’est le Président qui l’a dit. » J’ai cru qu’elle n’arriverait pas au bout de sa phrase. Ça déraillait dans son gosier. On aurait dit qu’elle cherchait son air. Là, son rot est sorti, un énorme, un monstrueux comme elle les aime. Elle a encore dit : « Voilà ! » et elle s’est recalée dans le canapé. Son regard s’est tourné vers la télé. J’étais plus là pour elle. Pour moi, si, par malheur. Il y a des moments où je sens le malheur sur moi et même en moi. Du coup j’ai l’impression d’être comme jamais, ou de ne plus être du tout, ce qui est un peu la même chose. Être vivant, sans raison de vivre, c’est décourageant, plus que ça, c’est absurde. Fallait que je sorte de moi-même ou que j’y reste.
Du coup, j’ai essayé de comprendre ce que ma mère voulait me dire. C’était très difficile vu que je suis tellement intelligent que je ne comprends même pas ce que je pense moi-même. C’est le propre d’un cerveau limité. Comprenne qui pourra, pas moi, vu que, comme j’ai expliqué, je suis trop intelligent.
Et si ma mère avait raison ? Il fallait que je fasse vite avant d’oublier ce qu’elle m’avait dit. Retenir plus de deux idées est déjà un exploit pour moi. Un jour je suis arrivé à quatre idées, le temps de le réaliser, elles s’étaient toutes barrées. Pour l’instant, j’en tenais deux. J’étais dans ma moyenne. Je m’y accrochais. Un : je devais traverser, deux : pour chercher le travail qui m’attendait de l’autre côté, comme avait dit un président. Il fallait que j’aille où ? De l’autre côté ! Nulle part, quoi ! C’est comme ça qu’on appelle l’autre côté. Mais, comme je viens, moi aussi de nulle part, aller nulle part c’est venir chez moi. Mais j’y étais déjà ! Bon que je me suis dit, réfléchis ! J’ai fléchi les jambes, une fois, deux fois, recommencé, réfléchi une fois encore pour faire bon compte. Ça amène de l’oxygène à mon cerveau et augmente ses capacités limitées d’homme intelligent. J’allais donc sortir de mon nulle part pour aller dans l’autre nulle part. Une histoire qui ne veut rien dire, tout en voulant dire quelque chose. Là je me suis trouvé génial ! Penser un truc pareil, c’est génial, tout simplement. C’est pas donné à tout le monde. Conclusion : Il fallait donc que je m’habille pour sortir.
J’ai mis mes meilleures pompes — j’allais en avoir besoin —, je me suis coiffé un peu, j’ai lavé mes mains, — fallait que je sois présentable. Mon pantalon, ça allait, la veste, c’était moins sûr, mais je n’avais rien de mieux. Alors j’ai mis une écharpe jaune pour cacher les taches et je suis sorti. Je commençais à descendre l’escalier en le montant, quand j’ai réalisé que j’avais oublié ma casquette. Erreur fatale, ma casquette m’est indispensable, c’est elle qui tient mon cerveau. Un « gardefolie » en quelque sorte. Sans elle, mes idées s’échappent encore plus vite. Je suis remonté pour descendre, une fois, deux fois, trois fois… À force de faire le yoyo, j’ai fini par reconnaître notre porte au bruit de la télévision. Un bruit que je n’entendais pas, mais qui devait exister quand même puisque chez moi, il y a toujours du bruit. Je ne suis quand même pas bête au point de nier ce que je n’entends pas. C’était comme une note silencieuse, ça doit bien exister, puisque je l’ai ressentie, elle avait même une odeur de tabac et un goût de bière. J’ai encore pensé que j’étais génial. Je venais d’inventer une note de musique qui n’émettait aucun son, mais qui était odorante et goûteuse. Je n’ai pas approfondi cette question, je la laisse aux plus cons que moi, ils en feront peut-être quelque chose. J’ai pris ma casquette et je suis descendu sans problème. J’ai cherché la porte de sortie, qui n’existait pas, et je me suis retrouvé au bord de la route.
Il faut que je vous dise que nous habitons, ma mère et moi, au bord de la route, vu que notre maison, c’est une station-service désinfectée, désaffectée, je veux dire… Le Président s’était donc un peu gouré ou bien c’était ma mère. Une route et une rue, c’est pas la même chose. Je ne me suis pas attardé sur cette question, j’avais déjà deux idées à retenir, c’était bien assez pour un intelligent comme moi. Je me suis d’abord concentré sur la première : traverser. C’est un truc impossible. Il y a un flot incessant de voitures. Des voitures qui ne s’arrêtent jamais à cet endroit, vu qu’il n’y a nulle part où aller ni de mon côté, ni de l’autre, comme je l’ai déjà dit. Il y a bien un passage pour piétons, mais qui l’emprunterait pour aller nulle part ? Je me suis planté devant le passage protégé que ça s’appelle. Avec mon écharpe jaune et ma casquette j’étais très visible, surtout que j’agitais les bras en faisant signe aux autos de ralentir. J’ai encore réfléchi à ma façon, en fléchissant sur mes jambes et je me suis posté avant le passage clouté. J’ai eu l’impression que les voitures ralentissaient. J’ai foncé en fermant les yeux. Je n’ai pas vraiment de raison de vivre puisque je suis vivant, alors ? Et bien les voitures se sont arrêtées. C’était donc que la règle avait changé, c’était avant le passage clouté qu’il fallait marcher. Fallait y penser ! J’étais de l’autre côté, j’avais traversé, j’avais fait ce que le Président avait dit.
Restait à trouver du travail. J’avais du chemin à faire. Je savais qu’il y avait une zone commerciale, droit devant, mais elle était loin. J’avais mes bonnes chaussures, mais je les ai retirées pour ne pas les user. Le chemin était long, je n’avais rien pour me distraire de ma deuxième pensée : chercher du travail. Parce que dans un nulle part, il n’y a pas de décor, pas le moindre brin d’herbe pour vous distraire de votre condition : marcher, marcher vers rien, sur un macadam qui vous échauffe les pieds. Il me semblait bien voir au loin quelques bâtiments alignés. J’ai pensé : « Ce doit être un mirage ». J’ai pourtant fini par arriver quelque part. C’est alors que j’ai lu le panneau : « Rue des boutiques abandonnées ». J’ai encore entendu cette note silencieuse. Elle était d’autant plus angoissante, celle-là, qu’elle n’avait ni odeur, ni saveur. En plus elle ne bougeait pas, elle ne vibrait pas. Elle était rien du tout, encore moins que rien, c’est vous dire. Une note abandonnée ! Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle durait.
À force de tendre mes oreilles, et mon crâne, et toute ma tête, et mes tripes, et, tout au fond de tout cela, mon pauvre cœur d’homme de nulle part, j’ai perçu un tumulte qui venait vers moi, me pénétrait, m’envahissait et hurlait : « Va chercher du travail, bon sang ! Y en a de l’autre côté de la rue ! ». C’était ma mère.
J’ai mis mes pompes. J’ai fait quelques flexions. J’ai fait demi-tour. Depuis, je vais de nulle part en nulle part. Mes chaussures n’en peuvent plus. Il ne faudrait pas que je perde ma casquette.
Emilie Kah
Lalande, Occitanie, 06 février 2020.

Mort du philosophe et critique
George Steiner !
"Le penseur et critique littéraire hors pair est mort lundi à Cambridge à l’âge de 90 ans. Son ironie n’épargnait pas notre civilisation.
La mort de George Steiner nous confronte à un paradoxe, celui de savoir pourquoi, dans une ère mondialisée comme la nôtre, la disparition d’un érudit polyglotte et nomade, d’un penseur errant entre les cultures, mais jamais superficiel, s’accompagne d’une nostalgie pour le type d’intellectuel qu’il a incarné et qui semble disparaître avec lui ?
Critique littéraire hors pair, théoricien de la traduction à laquelle il a consacré l’un de ses chefs-d’œuvre Après Babel (Albin Michel, 1978), comparatiste inégalé des littératures française, allemande et anglo-saxonne comme du théâtre, George Steiner aimait à se définir en « hôte » de la vie, en lecteur « invité » des grands écrivains avec lesquels il aura jusqu’au bout conversé.
Mais il ne manquait pas non plus, dans les nombreux entretiens qu’il a accordés, comme dans ses récits autobiographiques en forme de « bilan » (Errata, récits d’une pensée, Gallimard, 1998 ou encore ses Fragments (un peu roussis), Pierre-Guillaume de Roux Editions, 2012), de témoigner du pessimisme culturel que suscitait le spectacle de l’éloignement grandissant des « classiques » et l’évolution de la planète depuis Auschwitz –sans jamais que s’érode son ironie mordante, cruelle parfois, pour ceux qui en faisaient les frais. Dans ce milieu de grands bourgeois juifs assimilés et cultivés, on reçoit beaucoup l’avant-garde littéraire de l’époque. George Steiner s’est souvenu y avoir vu James Joyce intercéder auprès de son père pour lui éviter une punition.
Difficile en effet de comprendre l’itinéraire de George Steiner, qui est mort le lundi 3 février, à l’âge de 90 ans, à son domicile de Cambridge (Royaume-Uni), sans remonter au climat délétère des années 1930 et 1940, période de son enfance et de son adolescence, sur lequel il est souvent revenu.
Né à Paris le 23 avril 1929, son père d’ascendance tchécoslovaque Friedrich Georg Steiner, juriste de formation et haut cadre de la Banque centrale autrichienne, précocement effaré par la montée de l’antisémitisme, avait eu la clairvoyance de quitter Vienne dès 1924 pour la capitale française. Sa « mère viennoise jusqu’au bout des ongles » qui « commençait habituellement une phrase dans une langue pour la finir dans une autre » et dotée, quoique juive, du prénom wagnérien d’Else, renâclait devant l’exil.
Mais ce sont bien le 16e arrondissement parisien et le lycée Janson-de-Sailly qui forment le premier décor de la vie de George. Celui-ci vient au monde avec un grave handicap du bras et de la main droite qu’il surmonte grâce à l’obstination maternelle. Dans ce milieu de grands bourgeois juifs assimilés et cultivés, on reçoit beaucoup l’avant-garde littéraire de l’époque. George Steiner s’est souvenu y avoir vu James Joyce intercéder auprès de son père pour lui éviter une punition.
Départ pour New York
Pourtant, même s’il a toujours conservé sa nationalité française, George Steiner évoluera la plus grande partie de son existence dans le monde anglo-saxon, vers lequel l’oriente un second départ de ses parents pour New York, en 1940. Il y fréquente d’abord le fameux lycée français de la métropole américaine où cohabitent dans une ambiance insolite les enfants des diplomates de Vichy et les juifs (la Croix de Lorraine n’y sera arborée que fin 1944 !). Il poursuit ses études à Yale puis à l’université de Chicago (les grandes universités américaines s’ouvrant alors à peine aux étudiants d’origine juive).
Grâce aux cours du philosophe Leo Strauss, il entend parler de la philosophie de Martin Heidegger, compromis dans le nazisme, dont Strauss refuse de prononcer jusqu’au nom. La pensée de l’auteur d’Etre et temps va imprégner l’ensemble de l’œuvre de Steiner, tout réticent soit-il quant au personnage qu’il s’est abstenu de rencontrer. De même Steiner qui se disait « apolitique au possible » a-t-il nourri toute sa vie une fascination esthétique pour les penseurs et écrivains d’extrême droite que ce soit Céline (« shakespearien ! »), le philosophe royaliste Pierre Boutang ou le fasciste et antisémite Lucien Rebatet qu’il va voir à Paris dans les années 1960 (l’entretien est reproduit dans Le Cahier de l’Herne de 2003, dirigé par Pierre-Emmanuel Dauzat consacré à Steiner) ou encore le poète américain et admirateur de Mussolini Ezra Pound, parce qu’« il avait assumé la totalité de ses actes », précisait-il.
Il continue son cursus à Harvard et, grâce à une bourse, renoue, au début des années 1950, avec le Vieux Continent pour entreprendre un doctorat de littérature à Oxford. Ce premier travail, consacré à La Mort de la tragédie – il en fera un livre en 1961 (Gallimard, « Quarto », 2013) –, hérisse un jury de thèse offusqué par le style délibérément intuitif faisant fi des notes de bas de page et des bibliographies exhaustives. Après ce « Waterloo » académique, il représente plus tard, cette fois avec succès, une thèse dans les formes sur la poésie romantique, elle ne sera jamais publiée, elle est « abandonnée aux souris ».
George Steiner devient d’abord journaliste pour l’hebdomadaire The Economist, où il passe de 1952 à 1956 « les quatre meilleures années de sa vie », a-t-il affirmé un jour au quotidien britannique The Guardian. L’un de ses trophées fut une interview du « père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer » (1904-1967) à l’université de Princeton..
Contrairement à tant de ses collègues universitaires, il n’a jamais dédaigné le métier de chroniqueur de presse, même s’il l’a exercé par la suite surtout comme critique littéraire dans les 130 articles qu’il a rédigés pour le magazine américain The New Yorker de 1967 à 1997 (Lectures, Gallimard, 2010). Il succède dans cette rubrique à l’intellectuel new-yorkais Edmund Wilson (1895-1972). C’est aussi au début des années 1950 qu’il rencontre l’historienne des relations internationales Zara Shakow, doctorante de Harvard, qu’il épouse en 1955. Deux enfants naissent de ce mariage : David et Deborah.
George Steiner aimait surprendre, sinon choquer, et s’essayer à tous les genres, y compris le roman. Son Transport d’A.H. (Julliard/L’Age d’homme, 1981), récit des tribulations d’un commando juif en chasse d’un Hitler supposé vivant et réfugié en Amazonie, suscita non seulement la polémique mais convainquit son auteur qu’il était « un professeur, pas un créateur », comme il le confia à l’enseignante et écrivain Cécile Ladjali (Eloge de la transmission, Albin Michel, 2003).
Attaché à la culture biblique et à l’existence d’Israël, ce « diasporiste assumé »pouvait se montrer fort critique de l’Etat juif par haine du nationalisme en général et des cas de torture qui s’y étaient produits en particulier. Quoique s’affirmant « antisioniste », il s’y rendait souvent et fut l’ami du grand spécialiste de la Kabbale, Gershom Scholem (1897-1982). Pour lui, l’identité juive consistait avant tout à tenir « toujours ses bagages prêts ».
Relation maître-élève
Malgré une longue période passée à enseigner la littérature comparée à l’université de Genève, « la polyglotte », il s’implante à Cambridge, où il se plaît à la fréquentation des scientifiques de haut vol dans une cité fière de ses neuf Prix Nobel et dotée d’un pub, l’Eagle, où fut annoncé la découverte de l’ADN. Il y est l’un des professeurs fondateurs (fellow founders) du Churchill College.
Aimant l’enseignement, il met au cœur de sa réflexion la relation entre maître et élève « allégorie en acte de l’amour désintéressé » (Maîtres et disciples, Gallimard, 2003). Dans sa maison typiquement dressée sur un gazon humide, il montrait fièrement à ses visiteurs son exemplaire de Kafka signé par l’auteur. Chaque matin, dans son bureau situé au bout du jardin, il s’exerçait à traduire un texte dans « ses » trois langues (français, anglais, allemand) dont il ne sut jamais laquelle avait la préséance.
Il y avait du collectionneur chez George Steiner, qui affirmait avoir pris conscience de l’infinie diversité du monde grâce à une passion d’enfant pour l’héraldique ; un monde toujours divers et dont la prolifération le rendait fort méfiant et sceptique à l’égard des théories littéraires un peu trop systématiques, du structuralisme à la déconstruction.
Inlassable critique de la civilisation contemporaine, il ne ratait pas une occasion d’en fustiger les ridicules et d’en condamner les dérives, sans pour autant céder à la facilité d’une pensée réactionnaire ou antimoderne mécanique.
L’un des ouvrages typiques de son œuvre est sans doute Les Antigones (Gallimard, 1986 réédité en « Quarto ») où il applique conjointement ses talents de comparatiste, d’historien de la littérature et de philosophe, à penser l’épuisement d’un genre théâtral qui va de Sophocle à Anouilh. Il y démontre aussi la puissance intacte et l’actualité des auteurs les plus anciens (« Faire une lecture “classique” de Platon, de Pascal ou de Tolstoï, c’est tenter une vie nouvelle et différente »). Les tragédies antiques étaient, selon lui, des sources inépuisables de mythes – dont celui d’Antigone –, alors que la modernité peinait à en produire de durables, hormis celui de Don Juan et peut-être de Faust.
« Le texte classique, concluait-il, est un texte dont la naissance première, existentielle, nous est peut-être perdue (…) mais son autorité inhérente est telle qu’il peut absorber sans perdre son identité les incursions dont il est victime depuis des siècles, ainsi que l’accumulation des commentaires, des traductions et des variations qui s’accrochent à lui. Ulysse renforce Homère. La Mort de Virgile de Broch enrichit L’Enéide. L’Antigone de Sophocle n’a rien à craindre de Lacan. »
Malgré ses atrocités, George Steiner considérait comme un privilège d’avoir vécu au XXe siècle, tout en ayant conscience qu’il s’agissait probablement de l’un des plus « bestiaux » de l’histoire des hommes. Il n’en était pas moins un inlassable critique de la civilisation contemporaine dont il ne ratait pas une occasion de fustiger les ridicules et condamner les dérives, sans pour autant céder à la facilité d’une pensée réactionnaire ou antimoderne mécanique.
« Anarchiste platonicien »
« Je plaide coupable pour n’avoir pas compris que le cinéma était peut-être la forme la plus importante dans l’esthétique moderne, confia-t-il amusé au Monde en 2013. (…) Je confesse n’avoir pas compris non plus l’importance de la télévision ni saisi la révolution que cinéma et télévision ont engendrée. (…) De la même façon, j’ai beaucoup aimé les grands maîtres du jazz quand j’étais étudiant à Chicago, puis est venu le heavy rock, l’art conceptuel, et j’ai décroché. On ne peut pas tout aimer ni comprendre. Il ne faut pas essayer de bluffer. » Pour lui, une invention comme le téléphone portable privait l’homme « de son monologue intérieur »…
Cet « anarchiste platonicien » selon ses propres termes a, en dépit de son aversion pour le communisme, trouvé une grandeur, fût-elle « absurde », dans l’idéal d’un Trotski prétendant élever le type humain moyen aux sommets d’un Aristote, d’un Goethe ou d’un Marx. George Steiner s’affirmait du reste sceptique dans la capacité d’une « démocratie populiste qui rend possible des performances athlétiques et sportives de plus en plus éclatantes » à favoriser aussi « cet acte de rébellion, de révolte intérieure qui est au cœur de l’art ». Pour autant, il n’était pas dupe de la vertu civilisatrice de l’art et souvent revenait dans sa bouche l’exemple du bourreau nazi, capable de perpétrer un meurtre massif le matin et de jouer Schubert au piano le soir.
Récemment, il s’inquiétait de la torpeur – l’« acédie » – qu’il voyait se répandre dans la jeunesse soumise au chômage et à la précarité. Dans ses derniers écrits, il se prononçait contre l’acharnement thérapeutique et en appelait à « une révolution morale et légale », instituant l’euthanasie comme une « option élémentaire ».
S’il fallait imaginer un panthéon de la critique, nul doute que George Steiner y occupera une place de choix, aux côtés des plus grands, Erich Auerbach, Leo Spitzer, Jean Starobinski, Roland Barthes… Il s’en distinguerait peut-être par son style acerbe et son humour distancé. Adepte des « confessions négatives », il affectionnait de parler de la littérature par antiphrase, ce que montrent certains essais comme Les Livres que je n’ai pas écrits (Gallimard, 2008). Il s’intéressait aussi à la musique comme au « taire » (son Langage et silence, Seuil, date de 1969) qui investit une civilisation quand elle « n’est plus veillée par Apollon », où quand la diversité babélique des langues régresse. Pourra-t-on vivre dans son silence à lui ?" Le Monde, 04 février 2020.
Emilie K: Burn out !

BURN OUT
Regardez cet homme qui passe, là, dans le jour finissant. C’est vous. Un pardessus gris souris confortable, des chaussures qui ne blessent pas les pieds — vous ne marcheriez pas si aisément. Est-ce par coquetterie ou pour protéger votre crâne chauve que vous portez chapeau ? Les derniers rayons du soleil sont impuissants à réchauffer l’air glacé. Que diriez-vous de l’éclairage ? Qu’il est franc… C’est le mot juste ; la lumière dessine les contours de tout ce qu’elle touche. Quant aux âmes, quant à la vôtre, elle les pénètre jusqu’aux tréfonds.
Regardez-vous mieux, observez-vous, détaillez-vous : vous êtes cet homme qui marche dans la ville. Au bout de votre bras droit : votre serviette — votre servitude, car elle est votre outil de travail et contient tout ce qui est indispensable à un état que vous ne supportez plus. Votre main gauche vient de monter à votre visage. Est-ce pour vous gratter le nez ou pour la réchauffer de votre haleine. Car, tiens, vous n’avez pas vos gants. Vous les auriez oubliés, lors de votre dernière visite ! Comment avez-vous pu les laisser sur la table de votre patient ? Vous ne sortez jamais, jamais sans vos gants, l’hiver. Cette distraction ne vous ressemble pas. À ce constat votre raison vacille.
Vous voilà désaccordé. Pourquoi, aussi, vous appliquez-vous à être ce qu’on attend de vous — un personnage respectable et respecté de la ville. Est-ce si important d’être un homme important ? Que d’efforts on fait, dans la vie, pour se hisser au-dessus des autres ! D’où vient ce besoin ancestral de reconnaissance sociale. Vous vous êtes épuisé à cette tâche. Vous avez aussi épuisé les autres : Aurélie, votre épouse, pas assez bien pour votre famille, à laquelle vous avez été contraint d’apprendre les usages, vos fils qui, lorsqu’ils étaient classés seconds, vous entendait dire immanquablement : « Il n’y a qu’une place qui vaille, la première. »
C’est bien de vous qu’il est question. Mais oui, de vous : le docteur Pierre. Est-ce votre prénom ou votre nom ? Combien de fois ne vous a-t-on pas posé cette question. Pas dans cette ville où tout le monde connaît le docteur Jérôme Pierre, fils du docteur Alain Pierre, petit-fils de…
Qui songerait à contester votre légitimité à vivre et exercer votre art ici ? Quelqu’un vient de le faire ! À vous remémorer l’événement — car c’en est un pour celui que vous êtes —, vous voilà sidéré, accablé. Votre tête penche, vos épaules peinent à la tenir. Est-ce de fatigue, de colère, pire de honte ? Vous en avez oublié vos gants. Ressaisissez-vous, que diable, redressez-vous ! Que vous arrive-t-il ? D’où venez-vous pour être si chamboulé ? Des « quartiers », mais ce n’est pas la première fois que vous y allez. Toute agglomération a des quartiers qu’elle cache, qu’elle voudrait ne pas exister et qui régulièrement se rappellent à son bon souvenir par quelque fait délictueux : bagarre, incendie de voiture, viol, drogue, crime parfois. Vous en venez ; rien d’étonnant — ne vous appelle-t-on pas « le médecin des pauvres » ? Vous en auriez assez de cette étiquette ? Trop, ce serait trop ? Vous seriez bon jusqu’à un certain point ? La bonté n’a pas de limite ou n’est pas. Quoi ! les malades que vous venez de visiter vous ont insulté. Ils vous rendent responsable de leur délabrement physique, puisqu’il découle de leurs problèmes sociaux, environnementaux, pour lesquels des gens comme vous ne feraient rien. Ils ne manquent pas de logique, les gens des « quartiers ». Sans compter qu’ils vous ont jeté vos honoraires à la figure en vous disant que c’était de l’argent facilement gagné. Là, ils ont tort, il est difficile, harassant, jour après jour, année après année, de prendre en charge les maux des autres, de les écouter, de les réconforter, de les soigner au mieux de ses possibilités. La preuve ; ce soir vous êtes épuisé. Quoi, les études ? Elles sont difficiles. Vous n’avez pas de mérite, vous aviez les moyens intellectuels et financiers de les faire. Taisez-vous donc.
Vous êtes scandalisé, découragé de la nature humaine et de la vôtre. Remettez-vous, vous arrivez dans des lieux plus riants. Le pavement est propre et blanc, les trottoirs sont larges et accueillants ; on y entre dans le crépuscule d’un pas allant, presque joyeux. Dans cinq minutes vous verrez votre immeuble. Vous venez de ralentir le pas. Quoi ? Vous n’avez pas envie de rentrer chez vous. Vous ne rentrerez pas ce soir. Votre femme vous attend ; vous le savez. Hein ! vous ne voulez pas la voir vous tendre, avec son éternel sourire triste, le verre de whisky qu’elle vous aura préparé. C’est nouveau ça.
Mais que faites-vous ? Pourquoi vous asseyez-vous sur le trottoir, dos contre la façade de cet immeuble de bureaux. Auriez-vous un malaise ? Non, vos gestes ne sont pas altérés. Vous êtes tout à fait décidé à les accomplir. Vous avez mis votre serviette dans vos reins, relevé votre col, hésité entre croiser vos jambes en tailleur et les replier sur votre poitrine et… posé votre chapeau retourné devant vous.
Tout d’un coup, l’état de clochard vous a semblé le plus enviable. Plus de responsabilités, plus de femme à contenter, plus de fils à guider, plus d’ordonnances à rédiger, plus de formulaires pour la Sécu, plus de comptabilité... Vous soupirez de soulagement.
Vous n’avez pas encore froid.

Emilie K
Septembre 2019.
>Le message humaniste de L'Apocalypse de (saint) Jean !

Dans la tradition populaire non-exégétique judéo-chrétienne, l’Apocalypse est souvent synonyme de catastrophes, de destructions et de fin du monde. La sémantique du mot n’a pas ce sens. Il est la transcription d’un terme grec signifiant « révélation » ; à savoir un message caché que Dieu révèle aux Hommes destiné à éclairer l’avenir. C’est une variante de la « prophétie » ou plus exactement une forme de prolongement. Les Prophètes de la Bible entendaient les révélations divines dans leurs rêves et les transmettaient oralement, tandis que le sujet d’une apocalypse reçoit ses révélations sous forme de visions symboliques. Le genre eut un grand succès au sein de certaines communautés juives, tels les Esséniens de Qumrân, dans les siècles qui précédèrent la naissance de Jésus. Dans le Nouveau Testament, le canon chrétien n’a retenu qu’un seul cas, celui de (saint) Jean, auteur qui s’inscrit pleinement dans sa tradition juive d’origine, nourri des récits de la Genèse, de l’Exode, des Psaumes et des Textes des Prophètes. Nous sommes à la fin du 1er siècle de l’ère commune, Jean est en exil sur l’île de Patnos. L’Apocalypse, qui lui est attribuée, sans certitude scientifique, est un texte foisonnant, violent, mystique et inquiétant dans sa lecture littérale. Mais à l'analyse, sa charge symbolique révèle une condition humaine appelée à s’élever, à renoncer à ses démons, à apprendre à aimer. Il met en scène les forces du Mal, le diable et son armée d’anges déchus, et le Bien, Dieu, représenté par la figure de l’agneau. Pour bien le comprendre, il est nécessaire de le replacer dans son contexte historique : « une période de troubles et de violentes persécutions contre l’Eglise chrétienne naissante. Il s’agit donc d’un écrit de circonstance" (1) destiné à relever le moral des troupes. Mais comme dans certains films américains, tout finit par s’arranger, puisque l’Eternel triomphe de ses ennemis et offre à l’humanité pécheresse la rédemption, symbolisée par l’avènement de la Jérusalem céleste – contre-point absolu de la Babylone terrestre - non sans lui avoir imposé au préalable une série d’épreuves, sorte de parcours initiatique avant d’accéder à la Lumière. Les ordres maçonniques, rappelons-le, d’origine chrétienne, s’en sont inspirés dans leurs travaux. Certains hauts grades travaillent encore aujourd’hui sur l’évangile de l’apôtre Jean. Eclairés par les somptueuses tapisseries d'Angers, que nous avons eu la chance d’admirer en ce début août, L’Apocalypse de (saint) Jean y prend une nouvelle dimension, par l’amplitude de la tenture, avec ses 130 mètres de long, ses 84 tableaux et enluminures, répartis en 6 ensembles, quelques-uns manquants, aux couleurs vives, comme modernes, et ses scènes narratives d’une somptueuse richesse créative et patrimoniale. Ce chef-d’œuvre, classé monument historique, ne manque pas d’impressionner le spectateur par sa beauté artistique et poétique et sa puissance évocatrice et symbolique. « L’Apocalypse porte les visions douloureuses de la terre et les éblouissements du ciel. (…) Il ne s’agit pas de sonner la fin mais de trouver un surcroît de vie, un chemin spirituel. » (2). Au Moyen-Age, alors que la guerre et les épidémies déciment les hommes, le duc Louis d’Anjou commande à Hennequin de Bruges, peintre de son frère le roi Charles V, la plus grande tapisserie jamais réalisée, (…) chaque panneau ouvert par la figure d’un vieil homme (Jean), présence attentive et rassurante au milieu des bouleversements de l’histoire » (3). Cela pour préciser que cet ouvrage monumental, si il transcrit le Texte biblique en imageries inspirées par l’Eglise des premiers temps, fait aussi la part belle aux références médiévales dans ses paysages, ses édifices, ses décors et ses batailles. Nul besoin d’être croyant pour être sensible au message humaniste qui se dégage de l’œuvre. Celle-ci, comme tout ce qu'engendre l'art, nous renvoie à un dialogue temporel entre différentes époques, ici, l'Antiquité, le Moyen-Age et le XXIè siècle. L'humanité questionne sa condition à travers les âges. Elle interroge le mystère de l'infini et la quête de s'en approcher, mais elle y apporte des réponses relatives à la contemporanéité de ses sociétés. Rien n'est donc figé dans le marbre, car c'est le rapport de l'Homme à son temps changeant qui fait sa vérité. Pour conclure, nous ne saurions trop conseiller à nos lecteurs de prendre un jour le chemin du Maine-et-Loire, de la bonne ville d’Angers, jadis siège de la dynastie des Plantagenêt, et d’aller visiter ses demeures à colombages, comme la superbe maison d’Adam, édifiée autour de 1500, sa cathédrale Saint-Maurice, qui arbore deux tours de 75 mètres de haut, ses vitraux roses, et son colossal château médiéval des ducs d’Anjou (XIIIème à XVIème siècle), qui surplombe la galerie où est exposée la tapisserie. La forteresse est dotée de 17 tours et archères, elle est édifiée sur un promontoire qui domine la cité angevine et la clarté de son climat. Le 08 août 2019.
(1) La Bible de Jérusalem, L’Apocalypse, Introduction, Editions du CERF.
(2) Paule Amblard, Le chemin de L’Apocalypse, Editions Diane de Sellers.
(3) Paule Amblard, Le chemin de l’Apocalypse, Editions Diane de Sellers.
>Liberté, je te chéris mais dis-moi qui te brandit pour me piétiner !

Toni Morrison, Prix Pulitzer en 1988 et Nobel de littérature en 1993, est une des incarnations de la liberté à toute force.
Son oeuvre est dédiée à la condition noire, d'Afrique et d'Amérique, à la couleur blanche, impropre à la justice.
18/02/1931, Lorain, Ohio - 06/08/2019, New-York.
"La liberté n'a pas toujours les mains propres, mais il faut toujours choisir la liberté !"
André Malraux.
Mais qu'est-ce que la liberté ? Celle de penser, d'aller et venir, d'exprimer une émotion, un sentiment, une opinion, de s'engager et d'oeuvrer pour ce que l'on croit juste et équitable, de changer son regard, de créer, d'imaginer, d'inventer ce qui ne l'est pas encore, d'être ce que l'on est et de devenir autre. De vivre. Certes, mille fois assurément. Mais il y a aussi l'idée, formatée par les idéologies, les religions, les us et coutumes, les habitudes, la lassitude, l'idée que l'on se fait de la liberté, de son pluriel nécessaire. C'est alors le bal possible des horreurs, de la petite musique obsédante de vouloir un monde à son image, un monde en noir et blanc, de déterminer pour autrui ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de recourir aux grands discours sur la liberté, sans les conditionner à l'espace de l'Autre, comme l'exigerait le débat démocratique, en cherchant à les imposer pour une finalité improbable. Déclarer avec emphase, solennité ou dramaturgie des desseins qui ne mangent pas de pain, qui ne coûtent que la salive pour les ânonner, et faire l'impasse sur le chemin, le comment, car, "en dernière analyse", comme ils disent, les moyens justifient la fin. Et c'est alors que les mains sales, celles qui ont renoncé à rester propres, sont en mouvement, au nom rassurant du bonheur des peuples ou de son propre bonheur terrestre, quitte à sacrifier une part essentielle de l'humanité, sa diversité. Et c'est alors que la machine totalitaire, qui englobe un universel fantasmé, modélisé et martyrisé par la mécanique de la pensée déterministe, ainsi que les singuliers de nos petites vies absurdes et précieuses, se met à l'oeuvre. Robespierre, Staline, Mao, Pol Pot, Saddam Hussein, Bachar al Assad sont frères de sang et du mensonge, de cette façon bien à eux de guillotiner les leurs pour le bien de tous. Quant à ceux d'en face, ceux qui vocifèrent leur amour clanique, exclusif et raciste, qui crachent la haine d'autrui, du Juif, du Noir, de l'Indien ou de l'Arabe, qui découpent en morceaux choisis le genre humain, au nom d'une supériorité eugéniste aussi délirante que le bonheur trafiqué des précédents, chacun sait la pauvreté extrême de leur pensée, le bilan tragique de leur passif et le funeste de leur projet. Gobineau, Maurras, Hitler, les suprémacistes états-uniens, les populistes européens, leurs cousins d'Asie et d'Amérique, Le Pen, Orban, Salvini, Duterte, Bolsonaro, bien d'autres encore, au-delà du temps et de l'espace, sont liés par le pacte de l'apocalypse, pas celle qui révèle la dimension spirituelle du genre humain, sa quête universelle de l'amour. Non, celle primitivement vouée à la domination, à la soumission et à la destruction, au service des quatre cavaliers de la conquête, de la guerre, de la famine et de la mort; eschatologie de la fin de tout, du tout. On songe à la guerre nucléaire, toujours possible, avec l'actuelle relance de la course aux armements, ou à la collapsologie environnementale (*), liée au réchauffement climatique, aux atteintes à la biodiversité et aux catastrophes naturelles. Liberté, liberté, j'écris ton nom, oui, je te chéris, mille fois oui, mais dis-moi qui te brandit et t'inscrit sur sa bannière pour me piétiner au nom de mon bonheur, de mes origines, de ma couleur de peau, de mes opinions ou du lieu où je vis. Lisons ou relisons Lucrèce, Baruch Spinoza, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Raymond Aron, Alexandre Soljénitsyne, Primo Levi, Elie Wiesel, Toni Morrison, Philip Roth, Salman Rushdie pour désapprendre à nous vendre aux idéologies politiques et religieuses, pour renouer avec le libre arbitre et divorcer des dogmatismes. Choisir le bon respect de la nature, le bien commun et la beauté de la fraternité. 07 avril 2019.
(*) Néologisme, qui vient du terme latin collapsus, participe passé de collabi, qui signifie tomber d'un bloc, s'écrouler,
s'affaisser, qui a donné en anglais to collapse, s'effondrer, et du suffixe logos, parole, discours, raison, relation,
en français, emprunt sémantique qui caractérise une démarche scientifique.
Mon amie, la romancière Emilie K, anime désormais un blog littéraire !

Depuis quelques mois, Emilie K, qui a déjà publié huit livres, dont cinq romans (1), et qui prépare l'édition d'un sixième, organise désormais des ateliers d'écriture dans sa belle et grande maison de Lalande, à Goudourville, nichée au sein de la magnifique campagne du Tarn-et-Garonne. A ses nombreuses qualités et compétences, romancière, musicienne, chanteuse et gestionnaire d'entreprise, elle vient d'en ajouter une nouvelle. C'est ainsi qu'elle a crée récemment un blog littéraire destiné à celles et ceux désireux de s'éveiller pleinement à la magie des mots sur papier ou écran blanc (2). Sur les conseils avisés d'Emilie, vous aurez à faire des exercices ludiques et intéressants; une pratique qui permet d'ouvrir l'imaginaire à l'aventure romanesque. C'est ainsi que les thèmes et sujets proposés peuvent être très variés, iconoclastes parfois, et que les consignes données relèvent souvent de petits défis personnels, si pas confortables, car la difficulté fait partie du genre, mais du moins bien agréables. Les ateliers comme le blog d'Emilie sont par ailleurs l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir le cercle de vos relations, peut-être aussi de découvrir la région et la demeure où elle vit. Un privilège par les temps qui courent. Je ne saurais trop vous conseiller de la contacter et de vous lancer, en sa bienveillante compagnie, plume ou clavier à la main. 20 mars 2019.

(1) Ses 8 livres publiés
*Lot et Garonne Paysages gourmets (beau livre) Editions de Borée 1991 (épuisé)
*Liens mortels en Pays de Serres (roman) Editions du Bord du Lot 2006
*Saphir Bonheur(roman) Editions du Bord du Lot 2008
*Fenêtre sur Lot (roman) Pleine Page Editeur 2009 (en vente chez l’auteur)
*Contes d’une chatte perchée (nouvelles érotiques) Editions du Bord du Lot 2010
*M. comme Duras (roman) Editions L’Harmattan 2011
*La petite flingueuse – Retour à Diên Biên Phu (récit hommage) Editions Parole 2012
*L’automate du vide-greniers (roman) Editions Parole 2014

Rappel aux distraits, ceci n'est pas un sexe !
Tableau, L'origine du monde, Gustave Courbet.
>Si Richard Wagner était antisémite, sa musique l'est-elle aussi ?

RICHARD WAGNER DIFFUSÉ "PAR ERREUR" SUR LES ONDES DE LA RADIO PUBLIQUE ISRAÉLIENNE.
La radio publique israélienne s'est excusée pour avoir brisé un tabou en diffusant un morceau du compositeur allemand Richard Wagner, boycotté en Israël depuis de nombreuses années.
La porte-parole de la radio publique israélienne a qualifié « d’erreur » la diffusion vendredi dernier du Crépuscule des Dieux par une de ses stations spécialisée en musique classique.
Le compositeur allemand, dont les œuvres imprégnées de nationalisme ont été adoptées au 20e siècle par le Troisième Reich, est notamment célèbre pour avoir été l'un des compositeurs favoris d'Adolf Hitler.
Si aucun des opéras de Wagner ne comporte d’éléments directement antisémites. Wagner exprimait sa haine des Juifs dans ses pamphlets. Le compositeur a fait paraître son article « Le judaïsme dans la musique » en 1850 sous le pseudonyme de K. Freigedank (Libre pensée) dans la Neue Zeitschrift für Musik de Leipzig. En 1869, il l’a republié sous forme d’opuscule et sous son propre nom. On peut y lire : « Le Juif, qui a un Dieu bien à lui, nous frappe à première vue par son aspect extérieur, et cela à quelque nationalité qu’il appartienne, et nous nous sentons, de ce fait, devant un étranger. Involontairement, nous désirons n’avoir rien de commun avec un pareil homme ».
Ses prises de position antisémites étaient particulièrement véhémentes. « Je tiens la race juive, écrivait-il, pour l’ennemie née de l’humanité et de tout ce qui est noble ». (…). Le judaïsme est en train de nous détruire, nous les Allemands, et je suis peut-être le dernier qui sache s’opposer résolument à lui, alors qu’il s’est déjà rendu maître de tout ». Wagner parlait aussi d’Untergang, (anéantissement) : « Mais considérez qu’il n’y a qu’un seul moyen de conjurer la malédiction pesant sur vous : la rédemption d’Ahasvérus, l’anéantissement ».
Il n'y a pas de loi en Israël interdisant de jouer Wagner, mais les formations musicales s'en abstiennent. La porte-parole a rappelé dimanche que « les instructions au sein de la radio israélienne demeurent les mêmes depuis des années : la musique de Wagner ne doit pas être jouée ». Elle a souligné dans un communiqué « la peine qu'une telle diffusion peut susciter chez les survivants de la Shoah écoutant la radio ».
Pour de nombreux Juifs, cette musique, riche, extraordinairement complexe et qui a énormément influencé l’univers musical, en est venue en quelque sorte à symboliser les horreurs de l’antisémitisme allemand. L’argument le plus souvent invoqué pour justifier le refus de jouer Wagner en Israël est le traumatisme que sa musique peut susciter chez les survivants de la Shoah. « S'il y a un endroit où seul Wagner peut être entendu », avait écrit le critique Alex Ross, critique musical américain en 1998 en faisant référence à Bayreuth, « il devrait également y avoir un endroit où l'on demande à Wagner de se taire ».
« Nous nous excusons auprès de nos auditeurs », a déclaré la porte-parole de la radio publique israélienne, estimant que « le responsable de l'émission musicale s'est trompé de choix en diffusant ce morceau ».
Si l’œuvre de Wagner reste taboue en Israël, elle a déjà été jouée à plusieurs reprises. Lors d'un concert de l’orchestre philarmonique d’Israël en 1981, Zubin Mehta, après avoir donné aux spectateurs l'occasion de quitter la salle, a dirigé le Liebestod de Tristan und Isold en guise de rappel. En réponse, Ben-Zion Leitner, un survivant de la Shoah et un héros de la guerre d’Indépendance, s’est dirigé vers la scène en montrant son estomac cicatrisé et en interpellant Mehta : « Joue Wagner sur mon corps ».
Vingt ans plus tard, Daniel Barenboim a dirigé le prélude de Tristan und Isold avec l'Orchestre philharmonique de Berlin à Jérusalem. Conscient que Richard Wagner était un antisémite de la pire espèce dont les propos sont impardonnables, Daniel Barenboim estime toutefois qu’il convient de permettre de le jouer en Israël car « Wagner n'appartient pas aux nazis et la musique doit l'emporter sur la politique ».
Jonathan Livny, président de la Israël Wagner Society a salué la diffusion de la musique de Wagner par la radio publique. « Nous ne diffusons pas l'opinion du compositeur, mais la belle musique qu'il a écrite. Celui qui ne veut pas écouter cette musique peut éteindre la radio ».
Wagner, qui a notamment inspiré Baudelaire, Mallarmé, Proust, Joyce, Mann, Kandinsky, Isadora Duncan et Eisenstein, a su exprimé musicalement le désir et le désespoir. Même des personnalités juives de premier plan ont mis en avant cette double qualité de Wagner. « Moi aussi, je crois avoir entendu un tel battement d'ailes pendant que j'écrivais ce livre. J'y travaillais tous les jours jusqu'à l'épuisement total. Ma seule récréation consistait à écouter la musique de Wagner dans la soirée, en particulier Tannhäuser, un opéra auquel j’ai assisté aussi souvent qu’il était présenté. C’est à chaque fois qu’on ne jouait pas cet opéra que je nourrissais des doutes quant à la véracité de mes idées ».
L’auteur de ces propos est le fondateur du sionisme politique : Theodor Herzl. Et le livre dont il parle dans cet extrait n’est autre que L’Etat juif !"
Editorial publié ce 03 septembre 2018 sur le site du Centre Communautaire Laïque Juif.
>L'heure tourne et ce qui te reste !

New York, c'est l'énergie au service du temps qui dévore,
seule l'écriture lui résiste !

L'oiseau n'est libre qu'en déployant ses ailes depuis le ciel vers la terre !
L’écrivain juif américain, Philip Roth, est décédé ce jour à Manhattan. Je l’ai découvert tardivement, il y a une vingtaine d’années. Comme à l’accoutumée, le train de la SNCB était en retard. J’attendais donc. La gare centrale de Bruxelles, jonction entre les gares du Midi et du Nord, a de vagues allures de Grand central, à New York, en moins grande et moins belle. M’impatientant, je décidai d’acheter des journaux que je ne lisais jamais, Le Figaro, The New York Times. Sans doute emportés par mes sensations post-américaines, je fus attiré par la couverture d’un livre de poche, au titre étrange, "Portnoy et son complexe". Bien sûr, depuis, j'ai appris que l'oeuvre "du plus grand écrivain du XXème siècle" était aussi immense que son auteur, réunissant une impressionnante collection de romans et nouvelles. De "Goodbye Columbus", 1962, à "Némésis", 2012, en passant par "Ma vie d'homme", 1976, "La leçon d'anatomie", 1985, "La Contrevie", 1989, "Les faits", 1990, résonnante autobiographie, "Le Théâtre de Sabbath", 1997, "Pastorale américaine", 1999, "La Tache", 2002, "Un homme", 2007, "Le Rabaissement", 2009, "Indignation", 2010 ... les chercheurs en littérature américaine s'adonneront pendant longtemps encore à l'étude d'un continent qui semble ne pas avoir de limite, entre le tragique de l'existence, le rire bienvenu, qui réconforte, et le chemin incessant entre les deux. Le temps est compté à New York, comme celui d'un TGV, seule la littérature lui résiste. De loin en loin, j’avais entendu quelques commentaires admiratifs ou sévères sur Philip Roth, réflexions outrées ou béates de connaissances et amis juifs et non-juifs. Le titre original en anglais du roman que j'avais en main était encore plus parlant, « Portnoy’s complaint », La plainte de Portnoy, suggérant au lecteur la vision du Cotel à Jérusalem, du Mur des Lamentations, qui renvoie chaque Juif qui s’y rend et y prie, son observateur aussi, à l'image du geignard obsessionnel, de la victime consentante du malheur d’être, à ses rituels féconds, comme une femme enceinte, à ses ritournelles stériles, comme un homme en onanisme. Ce n’est là évidemment qu’une interprétation, ma foi, plutôt malicieuse, voire malveillante, qui a connu et connait encore son succès, mais qui, tous comptes faits, dit quelque chose du quelque part de la condition singulière d'être juif. Le trajet entre la capitale belge et Liège, ma cité ardente, où vivait Ireine, ma maman, ainsi qu’une partie de ma famille, ne dure qu’une heure, par belle saison ... Ce fut la seule fois que je regrettai un temps si court ; je n’arrivai pas à terminer la lecture de Portnoy. Ce fut chose faite dès l’après-midi. Moi qui admirait le peuple juif depuis mon adolescence, qui cherchait en mon passé toute trace de sa judeïté, qui avait épousé une juive, avait une fille juive, fréquentait assidûment, en pur agnostique, il est vrai, la Torah comme le Talmud, je découvrais un récit montrant un avocat newyorkais écrasé par une mère juive insupportable, un fils hanté par les femmes non-juives et assimilé à une communauté petite-bourgeoise, dont il faut s'émanciper pour être libre. Je me rappelai ma découverte des films schizophrènes de Woody Allen, offrant sa totale liberté d'écriture cinématographique et son amour de "Big Apple" à une identité juive sous-jacente, toujours présente, souvent pesante. Plus sérieusement, me revint en mémoire mes lectures de Baruch Spinoza, son Traité théologico-politique : « Seule une ambition criminelle a pu faire que la religion consistât moins à obéir aux enseignements de l’Esprit-Saint qu’à défendre des inventions humaines, bien plus qu’elle s’employât à répandre parmi les hommes, non pas l’amour, mais la lutte et la haine la plus cruelle sous un déguisement de zèle divin et de ferveur ardente. » L'humour décalé d'Allen et la coupe réglée de Spinoza préparèrent sans doute en moi le scandale Roth. Je connaissais par ailleurs ces Juifs qui ont la haine d’eux-mêmes, des traditions mosaïques et même d’Israël. Mais je ne savais pas ou ne voulais pas savoir qu’une telle appartenance pouvait engendrer chez certains individus, en mal ou en quête d’identité, un tel désir de non identité, une telle soif d’être soi-même sans en passer par l’appropriation des autres. Etre juif, c'est être seul mais toujours accompagné, me disais-je, même si on ne le désire pas. Bien sûr, je n’en pensai rien, enfin, ne voulus rien en penser. Qu’un écrivain, aussi célèbre et talentueux que Philip Roth, invite la chenille juive à renier sa chrysalide, dès lors que la promesse du papillon soit aussi juive que le lépidoptère de sa genèse, choqua et fascina tout à la fois mes faibles certitudes et mes doutes salutaires. Voilà un homme libre, pensais-je, un homme dangereux parce que décapant, voilà ce que pèse la densité d’un écrivain, aussi juif qu'infidèle à ses racines, plus chaînes que liens à ses yeux, sorte de prison à ciel ouvert, qui n’en est pas une pour d’autres. Brouillé avec moi-même, lessivé par un livre de hasard et heureux de l’avoir été, j'observai avec réjouissance que je n’en continuai pas moins l’étude du judaïsme et de l’histoire du peuple juif, fruits juteux de l’Orient, ainsi que de leurs influences considérables sur l’Occident. Juifs et non-juifs, nous sommes tous des Nathan Zuckerman, plongés au mikvé du Tikkun Olam: "Penche-toi sur ton passé, répare ce que tu peux réparer, et tâche de profiter de ce qui te reste". 23 mai 2018.
Emilie vit dans le Tarn-et-Garonne. Ses romans se
passent le plus souvent dans ce Sud-Ouest tant aimé.
Paris ou la jouissance de la modernité !



Etant à Paris, nous en avons profité pour nous rendre, samedi 20, au Grand Palais, admirer l’exposition « Gauguin, L’alchimiste » et, dimanche 21, à la Fondation Louis Vuitton, pour (re)découvrir les trésors du MoMA newyorkais, présentés dans l’écrin magnifique de l’architecte américano-canadien, Frank Owen Goldberg, mieux connu sous le nom de Frank Gehry. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, il est notamment le concepteur du remarquable Musée Guggenheim d’art moderne de Bilbao et donc, plus récemment, celui de la capitale française. Au premier coup d’œil, un chien avec un chapeau reconnaitrait sa signature conceptuelle et spatiale. Deux journées entièrement remplies d’émotions, d’interrogations et d’apprentissage.
L’expo Gauguin se termine aujourd’hui, celle intitulée « Etre moderne, Le MoMA à Paris » fermera ses portes le 5 mars prochain. Commençons par la visite Gauguin. S’il fallait retenir une seule citation de ce voyageur continental et de l’esprit, ce serait celle-ci: « Ce que je désire c’est un coin de moi-même encore inconnu ». D’où certainement son goût immodéré pour l’ailleurs. « L’Alchimiste » ne s’est jamais contenté ni de son état, ni de son environnement, ni de la société dans laquelle il vivait. Tout conformisme était pour lui une petite mort. C’est pour cela qu’il a beaucoup travaillé les objets en divers matériaux, comme le bois, le grès, le métal. Même dans sa période bretonne, refusant tout réalisme, il n’hésitait pas à recourir aux aplats, aux choix chromatiques exotiques, saturant parfois la toile d’un climat pré-polynésien. Son passage en pays d’Arles fut comme une transition entre Pont-Aven et Hiva Oa. Très belle exposition où les mots sensualité et jouir ont toute leur place.
Visiter le « navire amiral » de la Fondation Vuitton, dans le Bois de Boulogne, est en soi une aventure esthétique. Suivre le parcours chronologique de l’art moderne au XXème et XXIème siècles, pour qui la modernité signifie autre chose que la mode, est une expérience humaine passionnante. Qu’est-ce qu’être moderne ? Ne serait-ce pas l’incessante révolution des regards, du regard, celui de l’artiste mais aussi celui du spectateur-acteur, dans le sens où la formulation de son ressenti est en dialogue permanent avec les œuvres ? Si vous êtes à Paris ces prochaines semaines, la Fondation Louis Vuitton de Bernard Arnault, proprétaire du groupe de luxe LVMH, et son exposition des œuvres du MoMA, est un incontournable.
Paris, le 22 janvier 2018.



>On ne peut séparer l'homme indigne Céline de l'écrivain, fût-il brillant !

En renonçant, pour l'instant, à éditer les pamphlets de Céline, Antoine Gallimard s’est rangé à la raison. Céline est un écrivain qui a certes révolutionné la langue littéraire, mais il a surtout utilisé son talent au service de ce qu’il y a de plus avilissant en l’Homme. Il a aussi permis, pendant l’occupation nazie, à tous les haineux antisémites de France et d’Europe, de recourir à sa délirante obsession. Le véritable culte que certains beaux esprits vouent à sa personne autant qu'à son écriture est un summum d'hypocrisie et de complicité. Comment peut-on, par une entourloupe esthétisante et racoleuse, distinguer l'homme indigne qu'il fut, de l'écrivain, brillant fût-il ? C'est le même individu, captif à jamais de cette double identité. Une certaine tradition académique, liée à une modernité approximative, liée au "Nouveau roman" ainsi qu'à l'école linguistique, a voulu, pour des raisons autant herméneutiques que pseudo-épistémologiques, expurger de l'analyse littéraire toutes dimensions biographiques des auteurs; considérant les informations personnelles du vécu et du quotidien comme une somme réductrice, appauvrissante, voire destructrice des oeuvres étudiées. C'est là évidemment un sophisme, car il ne faut pas être spécialiste en chambre de littérature pour savoir qu'un romancier, un écrivain, de manière explicite ou non, se nourrit de l'existence réelle et du monde passé, présent ou, par anticipation, futur pour construire ses récits. L'imaginaire ne part pas, ne peut partir en effet d'une création ex nihilo, à savoir de rien. C'est pourquoi, il est nécessaire de travailler la matière littéraire en parallèle, c'est-à-dire signifiant et signifié du texte en corollaire et articulation avec les éléments recueillis de la vie de l'auteur. Concernant Céline, en lisant l'oeuvre de l'écrivain, quelle que soit sa nature, il est impossible d'oublier ou de mettre de côté, par un artifice de confort moral ou de duplicité, le fanatique antisémite qu'il a été toute sa vie, non celui d'une simple posture formelle et intellectuelle, mais celui agissant, dans le cadre du contexte historique de l'avènement et du déroulement de la Seconde Guerre mondiale, sur le réel; entraînant dans son sinistre sillage paroles, gestes et actes répugnants de ses admirateurs et "frères et soeurs d'arme". Outre ces trois pamphlets ignobles, véritables torchons ("L’école des cadavres", "De beaux draps" et surtout "Bagatelle pour un massacre"), si on lit bien son livre majeur, dénué d’antisémitisme, qui lui a valu l’admiration de la critique littéraire et de l’étude universitaire, « Voyage au bout de la nuit », on peut y lire cette petite phrase qui en disait déjà long sur son amour de l’humanité: « La haine, ce piment de l’existence. » ... Louis-Ferdinand Céline.
12 janvier 2018.
>Une grande voix s'est éteinte !

Une grande voix s’est éteinte cette nuit. L’écrivain israélien, Aharon Appelfeld, est décédé à l’âge de 85 ans. Aux côtés de Irène Némirovsky, Etty Hillesum, Primo Levi, Elie Wiesel, Martin Gray, David Grossman, Amos Oz, Charles Lewinsky, Meir Shalev, Joseph Roth, Patrick Modiano, Philippe Grimbert, tant d’autres, Aharon Appelfeld aura porté le lourd fantôme de l’identité juive, celui de la Shoah, jusqu'à la fin. Dès mes premières lectures, sa puissance d’écriture aura marqué mon imaginaire comme ma pensée. Né à Czernowitz, en Roumanie, aujourd’hui l’Ukraine, le 16 février 1932, il connaîtra la barbarie nazie à l’âge de 8 ans, par l’assassinat de sa mère, en 1940, puis, avec son père, la déportattion dans un camp situé en Transnistrie. Il s’en évadera un an plus tard et survivra plusieurs mois dans les forêts ukrainiennes. Il sera recueilli par des soldats soviétiques et servira comme garçon de cuisine dans l’Armée rouge pendant 9 ans. Son œuvre est composée d’une quarantaine de livres, romans et recueils de poèmes. Parmi ceux-ci, je ne retiendrai que deux récits, qui incarnent, certes, partiellement, l’écrivain : « Histoire d’une vie », où il plonge dans la tragédie humaine, la sienne, poignante fusion entre notre route universelle et un chemin singulier. Itinéraire hallucinant tendu vers le dépassement vital, véritable résiliance, avant l’invention du mot par Boris Cyrulnik, inachevée cependant, tant le romancier israélien sera hanté toute sa vie par les ombres sauvages de son enfance. « Le Temps des prodiges », chronique d’une désagrégation d’une famille juive autrichienne. Un point commun à ces deux traversées : pas de sentimentalisme, un regard sans concession, une descente terrifiante mais non mortifère, en sa personne, dans un monde où être juif signifie souvent le bannissement. Car, pour survivre, il faut s’assimiler, disparaître en tant que juif, ou renoncer et mourir. Stefan Zweig, dans « Le Monde d’hier » dont je conseille la riche lecture à tout le monde, décrit cette lente dérive humaine face à la machine totalitaire ; lui et son épouse, Friderike Maria Burger, le 22 février 1942, refuseront la première proposition et choisiront la seconde. Ils se suicideront, côte à côte, dans une chambre d’hôtel de Pétropolis, au Brésil. Aharon Appelfeld recevra, en 1983, le prestigieux Prix d’Israël et, en 2004, le Médicis étranger. Il fut aussi professeur de lettres à l’Université Ben Gourion de Beersheva, dans le Sud d’Israël. Malgré la gravité des sujets abordés, il refusera obstinément d’être qualifié « d’écrivain de la mort », car, pour lui, « il faut être vivant pour écrire ». 4 janvier 2018.
>Mon échange avec Pierre Kroll n'a rien de caricatural !

Je rencontre de temps en temps Pierre Kroll, ici et là, le grand dessinateur liégeois qui fait la Une du "Soir" depuis des années. Pour l'anecdote, il est mon voisin, mais notre Plantu national, notre Joann Sfar. Nous ne sommes pas amis, mais nous partageons la même curiosité pour le temps qui passe et le monde qui va. Il fait partie en effet des meilleurs caricaturistes européens. Il est aussi un homme chaleureux, voire fraternel, et sensible aux critiques, surtout celles qu'il ressent comme injustes. Nous en avons plus d'une fois discuté, en accord et en désaccord, sachant tous deux que la perception des êtres et des choses est hautement subjective. C'est pourquoi, il est si agréable avec lui d'entendre la différence. Sur la photo, lors d'une visite à la maison. Le 22 décembre 2017.
>"L'homme est une force qui va ..." !



Les mots manquent parfois pour dire l’émotion. Que dire de l’hommage à Johnny Hallyday ? Il n’y a pas de précédent, si ce n’est celui de l’enterrement, à Paris, de Victor Hugo, le 1er juin 1885, où deux millions de personnes étaient venues saluer l’œuvre autant que l’homme des Misérables. La retenue et les pleurs, l’élan et la ferveur de tout un peuple, des plus humbles, les Jean Valjean, Cosette et Gavroche d’aujourd’hui, à ceux que l’on dit de l’élite, pour une fois ramenés à leur noble et fragile condition humaine, qui s’expriment tour à tour dans un palpable désarroi de marée humaine. Rien pour venir assombrir un triste et lumineux samedi de décembre. La catharsis de Johnny a permis d’éloigner les sombres divisions, de réunir les uns et les autres, ceux qui se parlent, s’estiment et s’aiment comme ceux qui s’évitent, s’ignorent et se détestent. Qui peut se prévaloir d’une telle unité ? Incroyables et belles images d’un cerceuil blanc, qui descend les Champs-Elysées, bordé par sa tribu de bikers et une foule innombrable, recueillie et investie par un moment de grâce et d’histoire. L’église de la Madeleine, en son écrin catholique, pour un temps suspendu, livrée au son très accordé et rythmique de quatre guitares qui résonnent en nos âmes pour mieux nous donner le blues, celui qui vient de là, qui vient du cœur, de la souffrance des êtres oubliés et perdus. Nashville, Tennessee, et Paris, Belleville, ne faisaient qu’une aujourd’hui. Les mots du cœur du Président Emmanuel Macron et de la justesse de Philippe Labro pour redonner du sens à toutes celles et ceux qui l’ont cherché depuis trois jours. Scotchés à nos écrans sans mensonge, nous regardions cette scène unique et magnifique comme des enfants qui vont devoir faire sans. Nous ferons sans, nous le savons, parce qu’« un homme comme sont tous les autres, un être intelligent, qui court au but qu’il rêva, est une force qui va … » Hernani, Victor Hugo. 9 décembre 2017.

>Jean D'Ormesson, ce catholique errant !

En 1990 , Jean d’Ormesson, ce catholique errant, publiait, chez Gallimard, « Histoire du Juif errant ». J’avais déjà beaucoup lu sur le peuple juif, des histoires allégoriques, symboliques, complexes, tragiques, burlesques et dérisoires. Mais jamais, jusque là, je n’avais approché, à travers l’espace et le temps, une narration, sur un sujet, faut-il le dire, plus vaste que l’océan, avec autant de bienveillance que de sensibilité. L’errance, ses passions, ses misères, ce prix payé par les Juifs pour avoir dénié à l’un des siens, Jésus, sa mission rédemptrice, l’errance, comme une seconde peau finalement endossée, l’errance, aujourd’hui, enfin plus mentale que spatiale, pour ne pas sédentariser les certitudes mortifères réservées aux démunis de la pensée. 5 décembre 2017.
« Je vois ce que c’est, dit Marie : c’est toujours la même chose. Du sang, des sièges, la fin de tout, l’espérance chevillée au cœur, la peur vague d’on ne sait quoi, l’attente d’un dieu inconnu qui peut prendre toutes les formes, qu’on défie et vénère et qui est peut-être le néant, et, courant à travers le monde comme un fil invisible qui tiendrait tout ensemble, l’amour. Demain ou après-demain, vous nous raconterez une passion, la fois d’après une bataille, et le tout se terminera à Florence ou à Bâmiyân, devant les portes de bronze ciselées par Ghiberti pour le petit édifice en face de la cathédrale … » Jean D’Ormesson, Histoire du Juif errant.
>Provocation suédoise ?
Le métropolitain de Stockholm se transforme souvent en galerie d'art. Il accueille nombre d'oeuvres d'artistes en tous genres. Liv Strömquist, née à Lund, le 3 février 1978, auteure de bande dessinée, a signé sur les murs du métro de la capitale suédoise une oeuvre engagée, tant sur les plans moral, politique qu'artistique. Très impliquée dans le combat féministe, elle ne craint pas la provocation, car celle-ci est pour elle un bon moyen d'interpeller et de questionner la société. Depuis quelques jours, les usagers des transports stockholmois peuvent observer, admirer ou réprouver un tableau qui ne laisse personne indifférent. Les menstruations féminines en sont le sujet, quittant ainsi la réserve morale dans laquelle elles sont confinées habituellement. Peu importe la finalité du message, avec lequel chacune et chacun peut ou non cohabiter. Au diable le jugement de la forme, de l'écriture, du style empruntés pour servir le message. Qui sommes-nous pour juger de l'univers d'un créateur pour condamner son rapport au monde ? Ne sommes-nous pas nos-mêmes soucieux de préserver cette part singulière de notre humanité intime ? Et si l'objet dérange, eh bien, tournons le regard vers d'autres horizons, mais ne sacrifions pas, jamais ce qui nous distingue d'une intelligence artificielle: la liberté. L'important n'est-il pas dans le privilège pour nos sociétés occidentales que représente la liberté de penser, de manifester, de participer, de voter, d'écrire, de composer, de jouer, de sculpter, de dessiner et de peindre ? Je ne suis pas sensible à l'oeuvre de Liv Strömquist. Elle ne me parle pas, ni du côté cérébral, ni du côté émotionnel. Mais pour rien au monde, il ne me viendrait à l'idée de vouloir la censurer. 7 novembre 2017.

Liv Strömquist, 39 ans.

>Au fil des jours, des nuits et de l'éternité !

"De deux choses lune l'autre est le soleil". Jacques Prévert.
"Elle est retrouvée. Quoi ? - L'Eternité. C'est la mer allée Avec le soleil." Arthur Rimbaud.
"Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles, La lune, au visage changeant, Paraît sur un trône d'argent, Et tient cercle avec les étoiles, Le ciel est toujours clair tant que dure son cours, Et nous avons des nuits plus belles que vos jours". Jean Racine.
>La beauté en préhistoire !

Aujourd'hui, nous sommes allés voir la caverne préhistorique Pont D'Arc, plus connue sous le nom de Grotte Chauvet, du nom de l'un de ses trois découvreurs, le 18 décembre 1994, non loin de Vallon Pont d'Arc, en Ardèche. Il s'agit de la parfaite réplique de l'originale, protégée de la visite du public, responsable potentiel d'une détérioration des peintures pariétales. Ce fut le cas pour la Grotte de Lascaux - 18 à 20.000 ans - ouverte au public pendant de trop nombreuses années. Quelle émotion ressentie devant ces oeuvres artistiques qui ont 36.000 ans ! J'ai pensé aux taureaux de Picasso, à la spiritualité de Chagall, au mouvement de Van Gogh, à la lumière de Renoir. Bien sûr, cette analogie est anachronique, artificielle et exagérée, mais comment ne pas admirer ces hommes qui maîtrisaient de nombreuses techniques picturales et qui ont voulu ainsi, aux jours plus tempérés revenus - les ours et lions des cavernes y hibernaient et n'auraient fait que simples bouchées des êtres humains - projeter sur des parois leurs représentations souvent réalistes, parfois abstraites. Ils chassaient et cueillaient, semi-nomades, appelés par la science moderne les Aurignaciens, du nom du village d'Aurignac, en Haute-Garonne. Ces Aurignaciens ont migré vers nos contrées occidentales, il y a 40 à 50.000 ans, alors en pleine période glaciaire, supplantant en quelques milliers d'années les Néandertaliens, au mode de vie plus rudimentaire. Si vous voyagez dans le Sud de la France, n'hésitez pas à faire le déplacement vers ce lieu magnifique, à haute valeur culturelle, et qui nous rappelle que nos lointains ancêtres étaient des êtres plus raffinés que ne l'ont décrit certains de nos cours de préhistoire. 6 octobre 2017.
>Françoise Nyssen, femme de Lettres et cheffe d'entreprise, à la Culture !

Le tout nouveau gouvernement du Premier Ministre, Edouard Philippe, et du Président de la République, Emmanuel Macron, a réservé de belles surprises (*). Parmi celles-ci, la nomination de Françoise Nyssen, née à Etterbeek, commune bruxelloise, en 1951, à la tête du prestigieux ministère de la Culture. Directrice de la maison d'édition Actes Sud, référence par ses choix éditoriaux, elle a succédé à mon ami, Hubert Nyssen +, son père, que j'ai connu lorsque je vivais à Arles, né à Bruxelles, en 1925, et décédé en 2011, à Paradou, petit hameau des Alpilles. Pour moi, voir cette femme de culture talentueuse accéder à un poste trop souvent négligé ces dernières années est un gage de qualité et une belle promesse. Actes Sud, c'est d'abord l'œuvre d'Hubert Nyssen, le Bruxellois, de Boitsfort, plus précisément, naturalisé français dans les années '70, entre beaucoup d'autres choses, professeur de Lettres dans les universités de Liège et d'Aix-en-Provence, Docteur honoris causa de l'Université de Liège (ULg), en 2003, j'étais présent, et Officier de la Légion d'honneur en 2005. Génial inspirateur, découvreur exceptionnel et éditeur visionnaire, Actes Sud, c'est en 1978, romancier lui-même et scrutateur de nos travers. Un monument, que j'ai eu la chance de rencontrer, début des années '90, lorsque je résidais dans cette petite ville d'Arles, non par le territoire, le plus grand de France, mais par le nombre de ses habitants, 50.000, où beaucoup de personnes se connaissent. Tu le sais, j'y ai des amis et j'y ai gardé de nombreux contacts. J'ai pu l'approcher dans l'intimité, chez lui et au Méjean, où la maison d'édition est toujours installée, tout à côté du cinéma indépendant éponyme, et j'en ai gardé une admiration sans cesse revivifiée. C'est en effet lui qui nous a permis de découvrir notamment, Nina Berberova, "L'Accompagnatrice", Paul Auster, "Léviathan", Laurent Gaudé, "Le soleil des Scorta", et Nancy Huston, "Lignes de faille" ... Françoise Nyssen a su enrichir et embellir le catalogue de la maison, en développant intelligemment le patrimoine spirituel, intellectuel, romanesque et commercial que son père lui a légué. Ce mélange belgo-français des Nyssen, dans lequel je me retrouve totalement, vu mes origines mixtes, a donné à la littérature mondiale ses lettres d'allégresse. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de l'arrivée à la Culture d'une grande dame cultivée et si bien avisée. 18 mai 2017.
(*) Voir Champ & Contre-Champ, Le gouvernement du Président de la République, Emmanuel Macron !
>Nos amis les livres !

Les livres ont toujours participé de ma vie intime et sociale. Ils ne sont pas pour moi une vague distraction. Ils ne tapissent pas que les murs du salon et du bureau, ils sont les plans de mon architecture, ils soutiennent tout mon être. Le premier tracé fut la lecture par ma maman de "Paroles", de Jacques Prévert. J'avais, je crois, cinq ans. Ireine, c'était elle, appartenait à ces personnes absorbées par un monde intérieur, qu'elle ne pouvait partager qu'en lisant les récits qui sublimaient sa vie. Je fus le réceptacle, plus que d'autres, plus que mes soeurs, parties conquérir le monde, d'une soif de partage sans prétention parce que réservée. Ses récits, elle se les appropriait. Bien que dévoilant au gré des sons et des images une musique singulière, ils ne me permirent pas de maîtriser un tant soit peu un quelconque langage musical, pourtant universel. J'en suis juste le compagnon. Maman Ireine le pratiquait dans sa cuisine comme sur les scènes des salles de spectacle du Pays de Liège. Entre deux crises de mélancolie, elle chantait des airs de jazz américain et des chansons françaises, "My heart belongs to Daddy", "Mon amant de Saint-Jean" ... Ainsi, une voix grave et suave distilla savamment entre mes oreilles un délicieux mélange romanesque et lyrique. Je ne m'en suis jamais remis. Ces histoires, devenues miennes, par la magie du transfert, m'ouvrirent ainsi les portes d'une autre partition, plus universelle encore, celle de la quête d'une liberté acquise par l'amour d'une mère. Car lire, c'est être libre. Chez mes parents, de la cave, bien réelle, au grenier imaginaire, lieu où je projetais les aventures découvertes dans les pages du soir, tapi dans mon lit, sans que j'en convienne, je me construisais un regard actif au travers la fréquentation de celui des auteurs. Il y eu bien d'autres textes, qui alimentèrent en moi l'absolue nécessité de lire. Je me consolai ainsi, plus d'une fois, de la perte des êtres chers, en parcourant les histoires d'ailleurs, qui ne l'étaient pas tant que ça. Celle de mon papa, Charles, mort trop tôt, en 1980, car je crus reconnaître sa générosité à mon égard, en lisant ce passage, de "Fanny" de Marcel Pagnol: "(...) Panisse: Toi tu es celui qui est parti comme un vagabond, en abandonnant la fille qui t'avait fait confiance. Et si un honnête homme l'a sauvée du déshonneur et des commérages, tu ne peux que lui dire merci. (...) Fanny, il y a une très grave question qui se pose. Je ne sais pas ce que Marius t'a dit avant que j'arrive. Mais à moi, il m'a dit qu'il avait l'intention de réclamer sa femme et son fils. (...) Pendant ces dix-huit mois de bonheur, je me suis fait souvent des reproches, surtout quand je te voyais, au début, inquiète, pensive, et même triste. (...) Laisser l'enfant ? Ça c'est impossible !" (...). Moi, je n'ai jamais pu dire merci à cet homme d'avoir été un papa pour moi sans être un père. J'ai relu récemment "La promesse de l'aube", de Romain Gary. Comment ne pas penser à Ireine, disparue en 2011, lorsque je lis ceci ? "(...) Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait pas les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret; elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon bifteck avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait avidement (...)". Bien sûr, chez nous, nous mangions à notre faim, et rien ne manquait vraiment, mais le sacrifice d'une mère pour son enfant est une chose qui, à la maison, ne fut pas qu'une évocation livresque. La figure d'une mère à l'âme chevillée à la survie de sa progéniture ne transfigure-t-elle pas toute représentation imaginaire ou réelle de l'amour ? Dans la nuit du 1er au 2 mai 2001, nous avons perdu Barbara, ma petite belle-soeur. Elle était comédienne et avait 25 ans. Elle fut égorgée et décapitée par son petit ami qui, junkie, sous l'effet des drogues et de l'alcool, ne supporta pas qu'elle lui annonce leur séparation. "Nous sommes trop différents culturellement", m'avait-elle dit, une semaine auparavant. Lorsque j'ai en mains "Une femme fuyant l'annonce", de David Grossman, il est certain que le vide laissé par la disparition brutale de son fils cadet, Uri, mort au combat au Sud-Liban, en août 2006, fait remonter la souffrance de l'annonce puis du deuil infini que nous partageons avec le grand romancier israélien. La littérature n'est pas innocente. Elle parle de nous, de nos failles, de nos lâchetés, de nos grandeurs, des beautés cachées, parfois introuvables, sous la boue du vacarme du monde. C'est aussi pour ça que j'aime lire. Retrouver l'héroïsme de la condition humaine, derrière la grisaille ou le bleu délavé de nos façades fatiguées, est plus qu'une hygiène de vie, c'est la survie. Je vous dirai encore que "Belle du Seigneur", d'Albert Cohen, a rempli mes heures le temps d'un amour douloureux. La quête de l'âme soeur, lorsqu'elle s'arrête par manque de désir de l'autre ou surgissement de l'impossible, est une mort, quoi qu'il advienne, surtout si on en réchappe: "Assise devant la table, elle sortit de leur boîte les cachets, les compta. Trente, trois fois plus qu'il n'en fallait pour les deux. (...) Elle porta le verre à ses lèvres, goûta à peine. Il y avait des paillettes au fond. (...) Elle a été sage, elle a tout bu. (...) Oui, tout bu, il ne restait plus rien dans le verre, elle avait avalé les paillettes, elle les sentait amères sur la langue. Vite, allez voir. (...) Il but d'un trait, s'arrêta. Le meilleur restait au fond, il fallait tout boire. Il agita le verre, le porta à ses lèvres, but les paillettes du fond, son immobilité. (...) Alors il la prit dans ses bras, et il la serra, et il baisa les longs cils recourbés, et c'était le premier soir, et il la serrait de tout son amour mortel. (...)". Comment ne pas renaître à l'amour perdu, lorsqu'une aussi belle scène nous vient du plus loin et du plus grand de la littérature française ? Ne croyez pas que mes lectures soient tristes ou ternes, même derrière le tragique de l'existence, traité et retraité de mille manière dans la littérature, je puise une énergie et un bonheur de vivre, car je sais, plus que celle ou celui qui ne lit pas, que nous sommes vivants.
>Livre: Celui qui ne m'a jamais quitté !
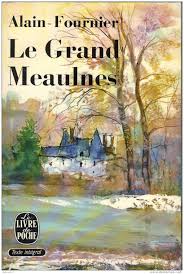

Il y a des récits qui vous marquent à jamais. Le Grand Meaulnes, d'Alain Fournier, parce qu'il résonnait dans toutes les fibres de mon âme, a embelli mon adolescence et ma vie d'adulte. Je relis ce roman chaque année, depuis 40 ans. J'ai aimé un garçon, nommé Alain, comme c'est étrange, ainsi que François a aimé Augustin. Je l'ai perdu tragiquement au cours de notre huitième année. Il n'a cessé depuis de me prendre la main, de me parler de la lumière de notre enfance, de nos jeux et balades sur les collines de Sainte-Anne, Bois du Barron, Piédroux, de la petite vallée verte du Ry-Poney, au sud-est de Liège, seuil de l'Ardenne infinie pour des culottes courtes. François, lui, a 15 ans, il est le narrateur du récit et fils de M. et Mme Seurel, instituteurs de Sainte-Agathe, en Sologne. Il fréquente le Cours supérieur qui prépare au brevet d'instituteur. Un mois après la rentrée, un nouveau compagnon de 17 ans vient habiter chez eux. "L'arrivée d'Augustin Meaulnes fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle" écrit-il. La personnalité mystérieuse d'Augustin, que les élèves appellent bientôt "le Grand Meaulnes", va troubler le rythme monotone de l'établissement scolaire et fasciner les élèves. Plus tard, il y aura l'aventure dans une Sologne aussi terrienne que céleste, la découverte d'une grande demeure et d'un trésor: l'amour pour Yvonne de Galais. Et puis la vie, les chemins de traverse, l'éloignement et la perte, qui servent, un jour ou l'autre, à reconstruire le rêve perdu.

<Extrait
« Nous partîmes sur la neige, dans un silence absolu. Meaulnes marchait en avant, projetant la lueur en éventail de sa lanterne grillagée … A peine sortions-nous par le grand portail que, derrière la bascule municipale, qui s’adossait au mur de notre préau, partirent d’un seul coup, comme perdreaux surpris, deux individus encapuchonnés. Soit moquerie, soit plaisir causé par l’étrange jeu qu’ils jouaient là, soit excitation nerveuse et peur d’être rejoints, ils dirent en courant deux ou trois paroles coupées de rires. Meaulnes laissa tomber sa lanterne dans la neige, en me criant : « Suis-moi, François … ».
>Livre: Penser contre soi-même !

Je viens de terminer de lire cette somme extraordinaire qui, depuis l'émergence de l'islam, au VIIème siècle, en Arabie, plus de deux mille ans après l'émergence du judaïsme, au XVème siècle avant l'ère chrétienne, retrace les liens ancestraux, riches et complexes, qu'entretinrent juifs et musulmans. Les minorités juives, en terre arabo-musulmanne, ont eu à souffrir ou à se réjouir d'un statut menacé ou protégé, sous l'effet de l'interprétation fluctuante du concept de Dhimma, réservé aux gens du Livre, les juifs et les chrétiens. Leur liberté de culte était en effet soumise à une taxe qui matérialisait leur "soumission" à l'ordre de l'Oumma, la communauté islamique. Sous la direction scientifique d'Abdelwahab Meddeb et Benjamin Stora, l'un musulman, l'autre juif, tous deux professeurs d'université, ce vaste travail de recherche historique, au-delà du passé, entend permettre la préservation des liens entre les deux communautés - tout en intégrant le conflit israélo-palestinien, venu polluer la mémoire respective des uns et des autres - Il s'est agi, pour chacun des auteurs, de pouvoir "penser contre soi-même", afin d'ouvrir le champ d'une pensée critique de leur histoire respective. C'est grâce à cette connaissance approfondie de l'autre que notre civilisation, qui n'a pas à nier les identités, dès lors qu'elles se respectent, ce qui serait mortifère, pourra assurer à chacun, dans son individualité, et à tous, dans la vie collective, un vivre ensemble vital et salutaire. (19 février 2017).
>Portrait !

Ireine, ma maman, dessinée par Louis, 1954.
Tout a commencé avec ce portrait de ma maman, dessiné par un homme qui l'aimait et qu'elle a aimé. Il s'appelait Louis. Il est mon père, il fut mon géniteur. J'en parlerai plus longuement ailleurs. Enfant, je regardais ce visage souriant de jeune femme et voyais bien qu'il avait un rapport avec celui d'Ireine. Je me disais qu'il y avait quelque chose de fort et de magique à pouvoir ainsi retracer les traits d'une personne, d'un paysage, d'un objet. J'observais qu'il s'agissait là d'une tentative de retenir le temps doublée d'une tentation de redéfinir l'espace. Les années ont passé, j'ai voyagé. Ma curiosité m'a permis de promener mon appétit dans bien des musées, des galeries d'art et des salles de vente. J'ai eu la chance ainsi de pouvoir un peu aiguiser mon regard et de cultiver mon ignorance.
>Peinture !

La maison bleue, 1920, de Marc Chagall, ici, au Musée Boverie, à Liège, dont la Ville est propriétaire, avec huit autres tableaux prestigieux, grâce à la généreuse donation, en 1938, de deux mécènes, le Baron Paul de Launoit et l'industriel liégeois, Louis Lepage (le grand-père maternel de mon regretté beau-frère, Stéphane Nyst). Tout est déconstruit, recréé, projeté, fantasmé, à la face de nos regards indifférents, agacés, perturbés, intéressés ou émus. Chagall est juif, d'origine slave, il est né à Vitebsk, en Biélorussie, la passion se lit dans les mouvements de son pinceau, mais ses bleus oniriques sont méditerranéens. Il ne cessera à travers son art (peintures, fresques, vitraux) de chercher et d'interroger ses racines juives.
>Peinture et portrait !

Ecoutons Sacha Guitry nous parler de Claude Monet. Son admiration pour le peintre impressionniste est la mienne. J'aime me perdre dans ses tableaux, sa lumière pénétrante et réfléchie par la nature, les infrastructures et les personnages. "Impression, Soleil levant" est une ode au réveil de la vie, saturé par une sublime palette de couleurs. "Les coquelicots à Argenteuil" nous enivrent des effluves de deux femmes en promenade, elles-mêmes odorées aux parfums diffus d'une campagne délicieuse. "La Gare Saint-Lazare" fait voir la civilisation industrielle en marche, le bouillonnement des volutes de fumée d'une locomotive qui vient. "Le Bassin aux nymphéas" est une merveille, nature plus sublimée que domestiquée, comme un abandon aux forces de la beauté.
Impression, Soleil levant, 1872.

Les coquelicots à Argenteuil, 1874.
La Gare Saint-Lazare, 1877.
>Opéra !

L'opéra de Liège/Wallonie
a été entièrement rénové et inauguré en 2012

L'écrin magnifique de notre opéra
Hier soir, 31 janvier 2017, nous sommes allés voir et écouter "La Damnation de Faust", d'Hector Berlioz, à l'Opéra de Liège/Wallonie. Je ne peux pas dire que j'ai été séduit par la mise en scène de cet immense chanteur qu'est Ruggero Raimondi. C'est en partie grâce à lui et à José Van Dam que j'ai véritablement découvert l'opéra. En 1979, j'ai en effet assisté à la projection du film, Don Giovanni, de Joseph Losey. Raimondi était Don Juan et Van Dam Leporello. J'en suis sorti émerveillé et définitivement conquis par l'art total qu'est l'opéra. Bien sûr, je ne suis qu'un très modeste amateur. Mais hier, comment dire, je suis resté toute la soirée comme étranger à une oeuvre, qui, pourtant, par son propos poétique et philosophique, a tout pour plaire et même passionner. Le côté figé, répétitif des scènes, on change la tonalité mais guère la couleur, l'imposante structure métallique du décor, dont l'intérêt de sa manipulation poussive m'a échappé; tout cela m'a ennuyé. Pourtant, il y avait là l'excellent chef liégeois, Patrick Davin, à la direction musicale, et un orchestre qui, une fois chauffé, a exécuté une partition belle, sobre et forte. Et, en dépit des bonnes prestations du ténor américain, Paul Groves, dans le rôle de Faust, de la soprano géorgienne, Nino Surguladze - sa prononciation en français laisse à désirer - dans le rôle de Marguerite, et de l'excellent travail vocal du baryton-basse italien, Illdebrando D'Arcangelo, une voix de bronze, dans le rôle de Méphistophélès, rien n'y fit, je n'ai pu me captiver pour une intrigue, il est vrai, dont chacun connait l'issue (chez Gounot, la chute est différente). Saluons tout de même l'ensemble des choeurs, qui, ici, participent quasi constamment à l'action. Je suis en effet resté sur ma faim avec cette mise en scène peu inventive et trop classique, peut-être trop italienne, à mon goût. En revanche, le sublime final de la montée au ciel de l'âme de Marguerite m'a emporté, mais c'est à la musique du grand Hector que j'ai dû ce réveil émotionnel tardif.

Ruggero Raimondi

La parabole du temps ...

La salle à l'italienne de l'opéra de Liège
>Oeuvre en question !
Céline, le voyage au bout de l'humanité

Je ne disconviens pas que Céline puisse être considéré par certains comme un grand écrivain. Mais, moi, je ne peux séparer l'homme de haine de l'auteur moderne. Il est communément admis, dans les cercles académiques et universitaires, qu'une œuvre ne peut être réduite à la biographie de son auteur. C'est vrai. Mais comment faire l'impasse sur l'insupportable et découpler l'évaluation littéraire d'un activisme antisémite permanent au service de la cause nazie ? Car c'est bien ce qui ressort de ce voyage biographique au coeur de la pensée et de l'action de Louis-Ferdinand Céline et, pour tout dire, au bout de la nuit de l'humanité. Alors, oui, je l'avoue, il n'est pas pour moi un grand écrivain, car il fut un tout petit monsieur.
« Céline, la race, le juif. Légende littéraire et vérité historique », d’Annick Duraffour et Pierre-André Taguieff, Fayard,
>Peinture et société !

La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, Musée du Louvre
Delacroix peint ce tableau pour saluer le courage des insurgés de la révolution de 1848. Au-delà des circonstances, il est un symbole fort d'une République qui résiste, qui ne s'en laisse pas compter et qui brandit l'étendard de la liberté contre toutes les oppressions. Il nous dit aussi que le prix à payer en vaut la peine. Les armes de la rébellion ont changé, heureusement. Mais la nécessité de se lever, de dire non à l'intolérable et de proposer démocratiquement un autre chemin, celui de la pensée et de l'action, demeure d'une urgente actualité.
































